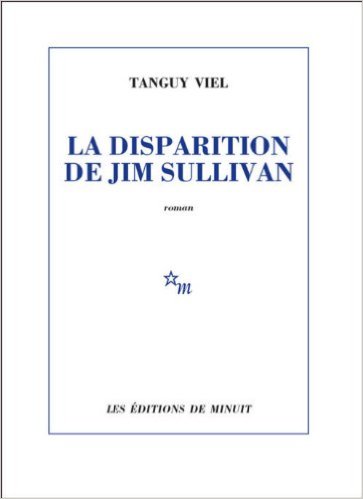
Ça aurait pu n’être qu’un livre de plus sur la vie sans relief d’un type au bord du rouleau, qui traine son existence dans une région utile uniquement à relier géographiquement deux coins dignes d’intérêts. Mais Tanguy Viel a décidé de nous épargner la lecture de son roman américain – qu’on imagine assez bien de l’avoir lu avant même qu’il ait été écrit tant il ressemblerait à d’autres –, pour préférer nous en raconter dans un court livre lisible en une seule insomnie. Et si le procédé n’est pas révolutionnaire1, s’il sera pénible la 50ème fois qu’on le retrouvera imité, pour le moment ne boudons pas notre plaisir. Et quand je dis “on”, c’est moi, qui ne l’ai pas boudé du tout.
Alors je suis rentré dedans à toute vitesse bien que le premier personnage présenté soit d’un immobilisme inquiétant. Je me suis posé la question, comme beaucoup de lecteurs je suppose, page 10, s’il était possible d’imaginer toucher un Chinois, un Australien et un Péruvien en même temps avec une histoire qui se déroulerait à Reims ou Chartres (même en se mettant dans la tête d’un étranger pour qui les noms de ces deux villes peuvent paraître exotiques) ou si le poids de leur cathédrale, leur surplus d’histoire quelque part, empêchaient ces villes de servir de décor neutre, « universel », à une histoire d’êtres humains au signifiant compréhensible sur tout le globe. Comme si la pauvreté historique des EUA, l’utilitarisme plat de ses bâtiments en assurerait paradoxalement son exportabilité. J’ai souri aux différents clichés que l’auteur égrène lorsqu’il nous présente l’idée qu’il se fait de l’Amérique et qui sont les mêmes que nous avons tous en tête pour les avoir vus des centaines de fois dans des films et séries qui aujourd’hui ne nous soutirent même plus l’effort de lever les yeux vers eux. Enfin, que je dis “nous”, je parle des gens normaux, dont, moi, qui ne les regarde plus du tout.
Et puis l’auteur se fait peu à peu entrainer par sa créature, et perd toute la distanciation qui était la sienne au début, et malgré sa petitesse, le livre perd en intérêt. Oubliant que sa méta-narration ouvrait un champ réflexif intéressant, celle-ci ne devient plus qu’un artifice formel qui lui permet de continuer ce dont on avait pourtant cru au départ pouvoir (ou devoir) se contreficher, puisque ce type et ce qu’il vit c’est aussi l’histoire d’une myriade d’autres et qu’on n’aurait jamais l’idée de s’intéresser à eux plus qu’à Dwayne Koster.
Arrivé à la 3ème partie (p. 85/153) j’ai commencé à compter les pages qui restaient, déçu que l’auteur n’ait pas été fidèle à ses premières pages, en me disant que j’avais été embarqué dans un voyage trompeur qui ne m’amenait pas du tout où on me le laissait entrevoir. Et du coup des quatre étoiles initiales que m’inspiraient ce livre, je suis passé à trois, pour terminer à deux, poussivement, étonné qu’on puisse ennuyer un lecteur en si peu de pages. Il aurait pu nous copier une blague « c’est un Américain, un Allemand et un Français qui… » toutes les dix pages, qu’on rigole un peu au moins… mais non même pas, on retombe dans le banal extraordinaire d’une histoire « à l’américaine » de base, où le 11 septembre 2001, la guerre en Irak et le FBI viennent se mêler… On n’en demandait pas tant. C’est un peu comme cette critique qui devrait s’arrêter là, avec une chute finale conclue par un bon mot, mais à part te dire, que cette lecture est tout à fait dispensable, je m’arrêterai là. Et quand je dis “tu” j’aurais dû écrire vous peut-être, car on n’a pas élevé des cochons dans le Missouri ensemble, du tout.
Bande-son
Note
- Laurent Binet m’avait auparavant enthousiasmé avec son HHhH. ↩︎
Photo d’entête : “Untitled” par A Hope Once Lost
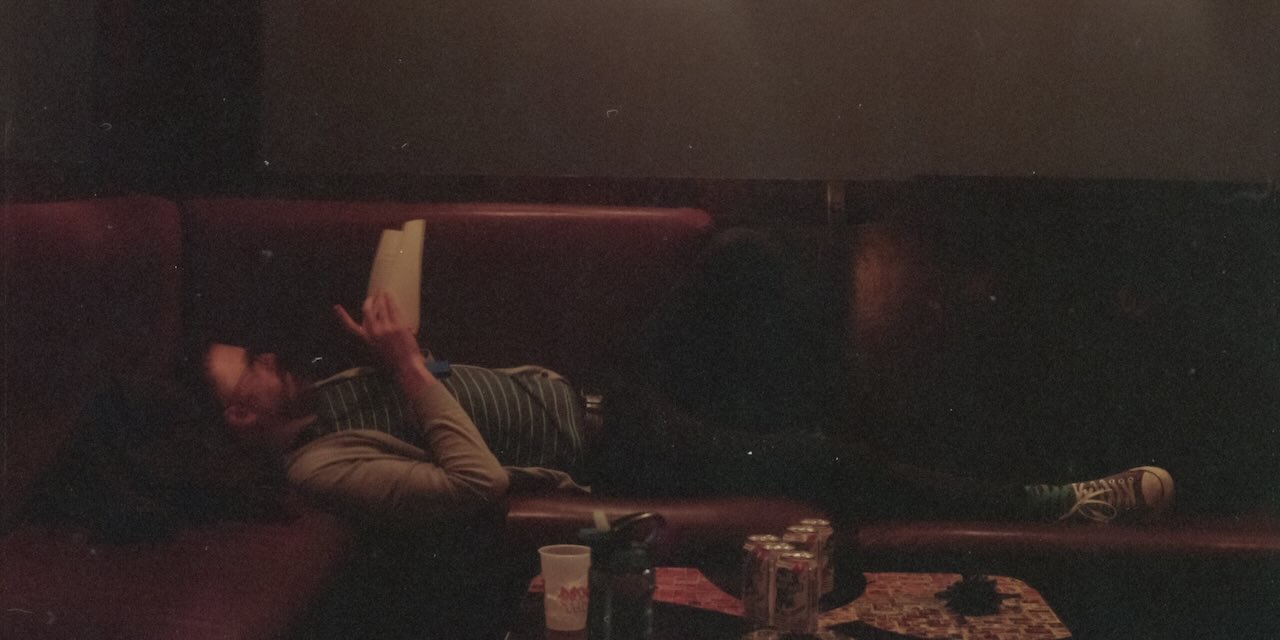
Laisser un commentaire