La question qui flotte au-dessus de ce livre n’est pas celle promise sur la quatrième de couverture – c’est-à-dire celle de la fin du monde et ses modalités, notamment à savoir si Dieu pourrait corriger son œuvre sans la détruire, et qui n’est véritablement posée que sur 6 pages [p. 232-238] – mais : pourquoi ce livre ?
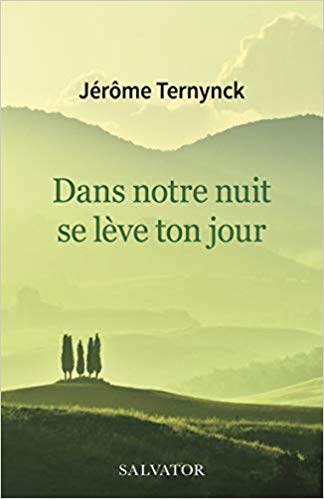
L’auteur paraît d’ailleurs si conscient de l’aspect totalement bancal de sa composition, qu’il en arrive même à être verbeux dans un court prologue annonçant ce qu’il va tenter de faire avec ce collage de cinq parties, dont quatre fragments (ou début ?) de romans et une cinquième “partie”, elle-même composée de deux extraits de journal intime sans intérêt et de six lettres à Dieu, suintantes de poésie adolescente. Dans ces lettres, un court passage relativement intéressant n’arrive cependant pas à sauver un livre qu’on ne prendra assurément pas dans l’arche-bibliothèque de Néo-Noé si le Déluge devait revenir et qu’il fallait sauver le patrimoine écrit de l’humanité. Se débattant comme il peut, Jérôme Ternynck ne parvient pas à faire illusion et dès le premier extrait de roman se déroulant en -167 avant J.C., laissé en plan après 26 pages bien que l’histoire fût potentiellement intéressante, le lecteur comprend que cela n’a aucun sens. Idem pour le deuxième extrait de (brouillon de) roman prenant place dans l’Empire romain, qui suscite encore plus de frustration puisque, bien qu’il ressemblât un peu trop à l’admirable Évangile selon Pilate d’Éric-Emmanuel Schmitt, il est très bien écrit. M. Ternynck peut bien ensuite, avant son troisième bout de roman, promettre une rencontre avec Saint Thomas d’Aquin1 comme un animateur de programme télévision vide doit exciter la curiosité du gros imbécile avachi devant sa télévision pour qu’il reste sur sa chaîne après cinq longues minutes de publicités idiotes, c’était peine perdue. Dès la page 88, il m’avait ennuyé et je comptai les pages restantes sans plus trop attendre beaucoup de la suite. En effet, pourquoi s’attacher à un (bout de) roman qui ne terminera pas ? Pourquoi s’extasier devant le tableau d’un peintre qui vous démontre sur un petit bout de toile qu’il pourrait imiter les plus grands mais préfère vous mettre sous les yeux sa palette en vous faisant croire qu’il y a là un chef-d’œuvre audacieux ? Lisant stoïquement, je me demandais surtout si l’auteur avait un livre à fournir à son éditeur par contrat et lui avait refourgué ses brouillons avec un peu de liant à la poudre de perlimpinpin pour faire croire à un ambitieux projet postmoderne sur la question de la fin des temps, et être ainsi quitte.
C’est d’autant plus dommage que, contrairement à bien des écrivaillonnes qui encombrent les librairies avec leurs romans inutiles écrits avec leurs nichons et quelques passages savants sous les bons bureaux, Jérôme Ternynck – dont je ne connais pas les autres livres – a du style et semble avoir quelque chose à dire… au moins jusqu’aux premières lettres (cinquième “partie”) où il nous raconte sa vie dans un flot de considérations mièvres sur la fragilité du monde et les nouvelles technologies dont je ne vois pas en quoi il pourrait intéresser ni Dieu ni un simple humain-lecteur. Là encore, il ne suffit pas d’évoquer le livre de Job pour être illuminé par la force du livre de l’Ancien Testament, et lorsque l’auteur se demande « comment m’y prendrai-je donc pour que les pages précédentes trouvent leur achèvement et non arrêt brusque, comme les pas du montagnard parvenu involontairement au pied d’une falaise verticale – confinant aux nuages – à moins que ce ne soit au bord d’un abîme » [p. 199], on a envie de dire que l’image est bien prétentieuse puisque cela fait deux cents pages que le lecteur ne fait qu’entrer dans des « chemins qui ne mènent nulle part »2 entre deux petits hameaux de vacuité, qui tient plus de l’assemblage de fragments de textes pour jobars que de Job.
Bref, la question n’était donc pas ici « quoi de la fin du monde ? » mais « à quoi bon l’existence de ce livre ; et surtout : quand finit-il ? »…
Reçu et lu dans le cadre de l’opération « Masse critique » de Babelio.
Bande-son
Notes
- Certes, le saint homme apparait bien le temps de se faire remettre un manuscrit, mais c’est assez ridicule de convoquer un grand nom pour lui donner un si petit rôle. ↩︎
- Les fameux „Holzwege“ de Martin Heidegger. ↩︎
Photo d’entête : “Scent Of Dawn …. Parfum D’Aube” par Guy Mayer

Laisser un commentaire