Sommaire du roman
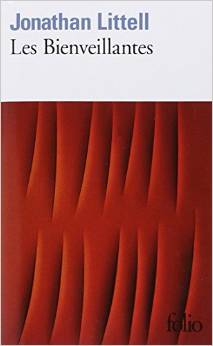
Ce pavé de près de 1400 pages (édition de poche) est le récit rétrospectif à la première personne de Maximilian Aue, revenant sur sa participation aux massacres de masse en tant qu’officier SS, entre ses vingt-cinq et trente ans.
Avec un ton d’observateur froid – il rédige des rapports aux autorités supérieures de la SS, ne prenant que très rarement le rôle d’exécuteur – le narrateur raconte, tout en effectuant de fréquents retours en arrière sur son enfance et sa jeunesse, son expérience de la guerre, les massacres, sa tentative désespérée de faire travailler les Juifs pour l’effort de guerre, son homosexualité, les déboires de son corps, et l’obsession incestueuse de l’amour qu’il porte à sa sœur jumelle.
Suivant le rythme des œuvres au clavecin de Jean-Philippe Rameau, Jonathan Littell a divisé le roman en sept parties :
- Toccata : elle constitue une sorte de prologue faustien où Maximilian Aue expose son projet et les raisons qui l’ont poussées à écrire. Dénué de mauvaise conscience, il ne cherche pas à se justifier ou à rendre des comptes, mais insiste sur l’aspect ordinaire des bourreaux et soutient que ce destin peut être celui de tous ceux qu’il appelle, avec François Villon, ses « frères humains ». Le lecteur apprend qu’il est, dans les années 60, un industriel spécialisé dans la production de dentelles quelque part dans le Nord de la France. Il a une vie rangée, est marié, a des enfants vis-à-vis desquels il n’exprime aucune affection.
- Allemandes I et II : membre des Einsatzgruppen, sur le front de l’Est] en Ukraine, dans le Caucase et en Crimée, il assiste aux massacres « à ciel ouvert », des Juifs ( »La Shoah par balles ») et des bolcheviques à l’arrière du front. Le chapitre s’achève par l’affectation-sanction du narrateur à Stalingrad.
- Courante : partie consacrée au siège et à la bataille de Stalingrad, dont Aue réchappe miraculeusement, bien qu’une balle lui ait traversé la tête.
- Sarabande : le narrateur effectue sa convalescence sur l’île de Usedom, à Berlin et en France. La mère et le beau-père du héros sont assassinés lors de son séjour chez eux à Antibes, très probablement par Aue, dans un moment de folie.
- Menuet (en rondeaux) : chapitre le plus long du roman. Affecté au ministère du Reich à l’Intérieur dirigé par Heinrich Himmler, il joue un rôle actif dans la gestion illusoire de la « capacité productive » du « réservoir humain » que constituent les prisonniers juifs. On entrevoit les rouages du IIème Reich, ses querelles intestines, sur fond de débandade annoncée. Appliqué à faire son travail, comme Eichmann le sien, les deux hommes se croisent et confrontent leurs intérêts respectifs contraires. Par ailleurs, deux commissaires, Clemens et Weser, chargés d’enquêter sur le meurtre de la mère du narrateur et de son compagnon, le soupçonnent très vite et n’auront de cesse de le poursuivre.
- Air : fuite du narrateur dans la propriété de sa sœur et de son beau-frère, en Poméranie, dans une orgie « bataillienne » de nourriture, d’alcool et d’onanisme où s’étalent les obsessions sexuelles de Max Aue.
- Gigue : relate la fuite d’Aue et son ami Thomas, venu le chercher dans sa réclusion, devant l’avancée des soviétiques, puis le séjour dans la capitale assiégée.
Toccata
Incipit
[13] Frères humains, laissez-moi vous raconter comment ça s’est passé. On n’est pas votre frère, rétorquerez-vous, et on ne veut pas le savoir. Et c’est bien vrai qu’il s’agit d’une sombre histoire, mais édifiante aussi, un véritable conte moral, je vous l’assure. Ça risque d’être un peu long, après tout il s’est passé beaucoup de choses, mais si ça se trouve vous n’êtes pas trop pressés, avec un peu de chance vous avez le temps. Et puis ça vous concerne : vous verrez bien que ça vous concerne. Ne pensez pas que je cherche à vous convaincre de quoi que ce soit ; après tout, vos opinions vous regardent. Si je me suis résolu à écrire, après toutes ces années, c’est pour mettre les choses au point pour moi-même, pas pour vous. Longtemps, on rampe sur cette terre comme une chenille, dans l’attente du papillon splendide et diaphane que l’on porte en soi. Et puis le temps passe, la nymphose ne vient pas, on reste larve, constat affligeant, qu’en faire ? Le suicide, bien entendu, reste une option. Mais à vrai dire, le suicide me tente peu. J’y ai, cela va de soi, longuement songé ; et si je devais y avoir recours, voici comment je m’y prendrais : je placerais une grenade tout contre mon cœur et partirais dans un vif éclat de joie. Une petite grenade ronde que je dégoupillerais avec délicatesse avant de lâcher la cuiller, en souriant au petit bruit métallique du ressort, le dernier que j’entendrais, à part les battements de mon cœur dans mes oreilles. Et puis le bonheur enfin, ou en tout cas la paix, et les murs de mon bureau décorés de lambeaux. Aux femmes de ménage de nettoyer, elles sont payées pour ça, tant pis pour elles. Mais comme je l’ai dit le suicide ne me tente pas. Je ne sais pas pourquoi, d’ailleurs, un vieux fond de morale philosophique peut-être, qui me fait dire qu’après tout on n’est pas là pour s’amuser. Pour faire quoi, alors ? Je n’en ai pas idée, pour durer, sans doute, pour tuer le temps avant qu’il ne vous tue. Et dans ce cas, comme occupation, aux heures perdues, écrire en vaut bien une autre. Non que j’aie tant d’heures que ça à perdre, je suis un homme occupé ; j’ai ce qu’on appelle une famille, un travail, des responsabilités donc, tout cela prend du temps, ça n’en laisse pas beaucoup pour raconter ses souvenirs. D’autant que des souvenirs, j’en ai, et une quantité considérable même. Je suis une véritable usine à souvenirs. J’aurai passé ma vie à me manufacturer des souvenirs, même si l’on me paye plutôt, maintenant, pour manufacturer de la dentelle. En fait, j’aurais tout aussi bien pu ne pas écrire. Après tout, ce n’est pas une obligation. Depuis la guerre, je suis resté un homme discret ; grâce à Dieu, je n’ai jamais eu besoin, comme certains de mes anciens collègues, d’écrire mes Mémoires à fin de justification, car je n’ai rien à justifier, ni dans un but lucratif, car je gagne assez bien ma vie comme ça.
Allemandes I et II
1941. Maximilien Aue est Obersturmführer – équivalent d’un lieutenant dans l’armée française – au service de sécurité de la SS, alors en Ukraine à l’arrière du front, sous le commandement de la 6ème armée. Indéfectible social-nationaliste, il n’en garde pas moins du recul face au génocide qui se met en place, ville après ville (et notamment le massacre de Babi Yar), et comprend la logique agonistique du régime hitlérien.
« Parole du Führer a force de Loi. Vous devez résister à la tentation d’être humains » ; « C’était sans doute pour ça que les Juifs étaient nos ennemis privilégiés, ils nous ressemblaient trop. » (p. 150-155)
[150] « J’ai à vous faire part d’une nouvelle pénible, [reprit Blobel]. Hier, le HSSPF Russland-Süd, l’Obergrüppenfahrer Jeckeln, nous a transmis un nouvel ordre. Cet ordre provenait directement du Reichsführer-SS et émane, je le souligne pour vous comme lui l’a souligné pour nous, du Führer en personne. En parlant, il tressaillait ; entre les phrases, il mâchonnait l’intérieur de ses joues. « Nos actions contre les Juifs devront dorénavant inclure l’ensemble de la population. Il n’y aura pas d’exceptions. » Les officiers présents réagirent avec consternation ; plusieurs se mirent à parler en même temps. La voix de Callsen s’éleva, incrédule : « Tous ? — « Tous », confirma Blobel. — « Mais c’est impossible, voyons dit Callsen. Il semblait supplier. Moi, je me taisais, je ressentais comme un grand froid, Oh Seigneur, je me disais, cela aussi maintenant il va falloir le faire, cela a été dit, et il faudra en passer par là. Je me sentais envahi par une horreur sans bornes, mais je restais calme, rien ne se voyait, ma respiration demeurait égale. Callsen continuait ses objections : « Mais, Herr Standartenführer, la plupart d’entre nous sont mariés, nous avons des enfants. On ne peut pas nous demander ça. » — « Meine Herren, coupa Blobel d’une voix tranchante mais également blanche, il s’agit d’un ordre direct de notre Führer, Adolf Hitler.
[151] Nous sommes des nationaux-socialistes et des SS, et nous obéirons. Comprenez ceci : en Allemagne, la question juive a pu être résolue, dans son ensemble, sans excès et de manière conforme aux exigences de l’humanité. Mais lorsque nous avons conquis la Pologne nous avons hérité de trois millions de Juifs supplémentaires. Personne ne sait quoi en faire ni où les mettre. Ici, dans ce pays immense, où nous menons une guerre de destruction impitoyable contre les hordes staliniennes, nous avons dû dès le départ prendre des mesures radicales pour assurer la sécurité de nos arrières. Je crois que vous en avez tous compris la nécessité et l’efficacité. Nos forces ne sont pas suffisantes pour patrouiller dans chaque village et en même temps mener le combat ; et nous ne pouvons pas nous permettre de laisser des ennemis potentiels aussi rusés, aussi fourbes, derrière nous. Au »Reichssicherheitshauptamt », on discute de la possibilité, une fois la guerre gagnée, de réunir tous les Juifs dans une grande réserve en Sibérie ou dans le Nord. Là, ils seront tranquilles et nous aussi. Mais d’abord il faut gagner la guerre. Nous avons déjà exécuté des milliers de Juifs et il en reste encore des dizaines de milliers ; plus nos forces avancent, plus il y en aura. Or, si nous exécutons les hommes, il ne reste personne pour nourrir les femmes et leurs enfants. La Wehrmacht n’a pas les ressources pour nourrir des dizaines de milliers d’inutiles femelles juives avec leurs gamins. On ne peut pas non plus les laisser mourir de faim : ce sont des méthodes bolchéviques. Les inclure dans nos actions, avec leurs maris et leurs fils, est en fait la solution la plus humaine au vu des circonstances. En outre, l’expérience nous a démontré que les Juifs de l’Est, plus procréateurs, sont le vivier originel où se [152] renouvèlent constamment les forces du Judéo-bolchévique comme des ploutocrates capitalistes. Si nous en laissons survivre certains, ces produits de la sélection naturelle seront à l’origine d’un renouveau encore plus dangereux pour nous que le péril actuel. Les enfants juifs d’aujourd’hui sont les saboteurs, les partisans, les terroristes de demain. » Les officiers se taisaient, mornes ; Kehrig, je remarquai, buvait coup sur coup. Les yeux injectés de sang de Blobel luisaient à travers le voile de l’alcool. « Nous sommes tous des nationaux-socialistes, continua-t-il, des SS au service de notre Volk et de notre Führer. Je vous rappelle que Führerworte haben Gesetzeskraft, Parole du Führer a force de Loi. Vous devez résister à la tentation d’être humains. » Blobel n’était pas un homme très intelligent ; ces formules si fortes ne provenaient certainement pas de lui. Pourtant, il y croyait ; plus important encore, il voulait y croire, et il les offrait à son tour à ceux qui en avaient besoin, ceux à qui elles pouvaient servir. Pour moi, elles n’étaient pas d’une grande utilité, mes raisonnements, je devais les élaborer moi-même. Mais j’avais du mal à penser, ma tête bourdonnait, une pression intolérable, je voulais aller dormir. Callsen jouait avec son alliance, j’étais certain qu’il ne s’en rendait pas compte ; il voulait dire quelque chose, mais se ravisa. « Schweinerei, c’est une grosse Schweinerei » marmonnait Häfner, et personne ne le contredisait. Blobel semblait vide, à court d’idées, mais tous sentaient que sa volonté nous tenait et ne nous lâcherait pas, tout comme d’autres volontés le tenaient, lui.
Dans un Etat comme le notre, les rôles étaient assignés à tous : Toi, la victime, et Toi, le bourreau. Personne n’avait le choix, on ne demandait le consentement de personne, car tous étaient interchangeables, [153] les victimes comme les bourreaux. Hier nous avions tué des hommes juifs, demain ce seraient des femmes et des enfants, après-demain d’autres encore ; et nous, lorsque nous aurions rempli notre rôle, nous serions remplacés. L’Allemagne, au moins, ne liquidait pas ses bourreaux, au contraire, elle en prenait soin, à la différence de Staline avec sa manie des purges ; mais cela aussi c’était dans la logique des choses. Pour les Russes, comme pour nous, l’homme ne comptait pour rien, la Nation, l’Etat étaient tout, et dans ce sens nous nous renvoyions notre image l’un à l’autre. Les Juifs aussi avaient ce sentiment fort de la communauté, du Volk : ils pleuraient leurs morts, les enterraient s’ils le pouvaient et récitaient le Kaddish ; mais tant qu’un seul restait en vie, Israël vivait. C’était sans doute pour ça qu’ils étaient nos ennemis privilégiés, ils nous ressemblaient trop.
Il ne s’agissait pas d’un problème d’humanité. Certains, bien entendu, pouvaient critiquer nos actions au nom de valeurs religieuses, mais je n’étais pas de ceux-la, et à la SS, il ne devait pas y en avoir beaucoup ; ou au nom de valeurs démocratiques, mais ce qui s’appelle démocratie, nous l’avions dépassé, en Allemagne, voilà un certain temps. Les raisonnements de Blobel, en fait, n’étaient pas entièrement idiots : si la valeur suprême, c’est le Volk, le peuple auquel on appartient, et si la volonté de ce Volk s’incarne bien dans un chef, alors, en effet, Führer worte haben Gesetzeskraft. Mais il était quand même vital de comprendre en soi-même la nécessité des ordres du Führer : si l’on s’y pliait par simple esprit prussien d’obéissance, par esprit de Knecht, sans les comprendre et sans les accepter, c’est-à-dire sans s’y soumettre, alors on n’était qu’un veau, un esclave et [154] pas un homme. Le Juif, lui, lorsqu’il se soumettait la Loi, sentait que cette Loi vivait en lui, et plus elle était terrible, dure, exigeante, plus il l’adorait. Le national-socialisme devait être cela aussi : une Loi vivante. Tuer était une chose terrible ; la réaction des officiers le montrait bien, même si tous ne tiraient pas les conséquences de leur propre réaction ; et celui pour qui tuer n’était pas une chose terrible, tuer un homme armé comme un homme désarmé, et un homme désarmé comme une femme et son enfant, celui-la n’était qu’un animal, indigne d’appartenir à une communauté d’hommes. Mais il était possible que cette chose terrible soit aussi une chose nécessaire ; et dans ce cas il fallait se soumettre à cette nécessité. Notre propagande répétait sans cesse que les Russes étaient des Untermenschen, des sous-hommes ; mais cela, je refusais de le croire. J’avais interrogé des officiers capturés, des commissaires, et je voyais bien qu’eux aussi étaient des hommes comme nous, des hommes qui ne souhaitaient que le bien, qui aimaient leur famille et leur patrie. Pourtant, ces commissaires et ces officiers avaient fait mourir des millions de leurs propres concitoyens, ils avaient déporté les koulaks, affamé la paysannerie ukrainienne, réprimé et fusillé les bourgeois et les déviationnistes. Parmi eux, il y avait des sadiques et des détraqués, bien sûr, mais il y avait aussi des hommes bons, honnêtes et intègres, qui voulaient sincèrement le bien de leur peuple et de la classe ouvrière ; et s’ils se fourvoyaient, ils restaient de bonne foi. Eux aussi étaient pour la plupart convaincus de la nécessité de ce qu’ils faisaient, ce n’étaient pas tous des fous, des opportunistes et des criminels comme ce Kieper ; chez nos ennemis aussi, un homme bon et honnête [155] pouvait se convaincre de faire des choses terribles. Ce qu’on nous demandait maintenant nous posait le même problème.
« Le meurtre des Juifs, ça ne peut avoir qu’un sens : celui d’un sacrifice définitif, qui nous lie définitivement » (p. 208-209)
[208] « Tu es devenu un vrai expert militaire, ma parole », commenta [Thomas]1. — « Pas du tout. Mais à force de passer ses journées avec des soldats on apprend des choses. Et puis je lis. Par exemple, j’ai lu un livre sur Charles XII. » Je gesticulais maintenant. « Tu vois Romny ? Dans la région où Guderian a fait sa jonction avec von Kleist ? Eh bien, c’est là que Charles XII avait son QG, en décembre 1708, un peu avant Poltava. Lui et Pierre manœuvraient avec des troupes chères, qu’il fallait économiser, ils dansaient l’un autour de l’autre depuis des mois. Puis à Poltava Pierre égratigne les Suédois et tout de suite ils se retirent. Mais ça, c’est encore la guerre féodale, la guerre de seigneurs soucieux d’honneur et surtout égaux entre eux, et donc leur guerre reste au fond courtoise, une sorte de jeu cérémonial ou une parade, presque du théâtre, en tout cas pas trop meurtrière. Alors qu’après, quand le sujet du roi, manant ou bourgeois, devient un citoyen, c’est-à-dire quand l’Etat se démocratise, là, la guerre, tout à coup, devient totale et terrible, elle devient sérieuse. C’est pour ça que Napoléon a rasé toute l’Europe : pas parce que ses armées étaient plus nombreuses ou parce qu’il était plus fin stratège que ses adversaires, mais parce que les vieilles monarchies lui faisaient encore la guerre à l’ancienne, de manière limitée. Alors que lui ne faisait déjà plus une guerre limitée. La France de Napoléon est ouverte aux talents, comme on disait, les citoyens participent à l’administration, et l’Etat régule mais c’est le peuple qui est souverain ; ainsi cette France-là fait naturellement une guerre totale, avec toutes ses forces mises en jeu. Et ce n’est que lorsque ses ennemis l’ont compris et ont commencé à faire la même chose, que Rostoptchine brûle Moscou et qu’Alexandre soulève les Cosaques et les paysans pour harceler la Grande Armée durant la retraite, la chance a tourné. Dans la guerre de Pierre Ier et de Charles XII, on ne risque qu’une petite mise : si on la perd, on arrête de jouer. Mais quand c’est la Nation entière qui fait la guerre, elle joue tout et doit miser encore et encore jusqu’à la banqueroute totale. Et c’est ça le problème. Si on ne prend pas Moscou, on ne pourra pas arrêter et négocier une paix raisonnable. Donc on devra continuer. Mais veux-tu que je te dise le fond de ma pensée ? Pour nous, cette guerre, c’est un pari. Un pari gigantesque, qui engage toute la Nation, tout le Volk, mais un pari quand même. Et un pari, tu le gagnes ou tu perds. Les Russes, eux, ne peuvent pas s’offrir ce luxe. Pour eux ce n’est pas un pari, c’est une catastrophe qui s’est abattue sur leur pays, un fléau. Et tu peux perdre un pari, mais tu ne peux pas perdre devant un fléau, tu es obligé de le surmonter, tu n’as pas le choix. » J’avais débité tout cela d’une traite, rapidement, reprenant à peine mon souffle. Thomas se taisait, il buvait son vin. « Et encore une chose, ajoutai-je vivement. Je te le dis à toi, à toi seulement. Le meurtre des Juifs, au fond, ne sert à rien. Rasch a absolument raison. Ça n’a aucune utilité économique ou politique, ça n’a aucune finalité d’ordre pratique. Au contraire c’est une rupture d’avec le monde de l’économie et de la politique. C’est le gaspillage, la perte pure. C’est tout. Et donc ça ne peut avoir qu’un sens : celui d’un sacrifice définitif, qui nous lie définitivement, nous empêche une fois pour toute de revenir en arrière. Tu comprends ? Avec ça, on sort du monde du pari, plus de marche arrière possible. L’Endsieg ou la mort. Toi et moi, nous tous, nous sommes liés maintenant, liés à l’issue de cette guerre par des actes commis en commun. Et si on s’est trompés dans nos calculs, si on a sous-estimé le nombre d’usines que les Rouges ont montées ou déplacées derrière l’Oural, alors on est foutus. » Thomas finissait son vin. « Max, dit-il enfin, tu penses trop. C’est mauvais pour toi. Cognac ? »
Courante
Sanctionné par ses supérieurs pour ne pas avoir défendu avec tout le zèle attendu la position meurtrière de la SS lors d’une affaire de Juifs des montagnes aussi anecdotique que révélatrice de l’aspect systématique du génocide des Juifs, Aue est envoyé à Stalingrad alors encerclée par les troupes russes. Affecté à des rapports dérisoires sur le moral des troupes allemandes, on lui amène un prisonnier russe germanophone pour un interrogatoire improvisé.
« Votre national-socialisme est une hérésie du marxisme » (p. 563-573)
[563] Où avez-vous appris [l’Allemand] ? » Il sourit de nouveau : « Tout seul à seize ans, avec des prisonniers de guerre. Après, Lénine lui-même m’a envoyé auprès des communistes allemands. Figurez-vous que j’ai connu Liebknecht, Luxemburg ! Des gens extraordinaires. Et après la guerre civile, je suis retourné plusieurs fois en Allemagne, clandestinement, pour entretenir des contacts avec Thälmann et d’autres. Vous ne savez pas ce qu’a été ma vie. En 1929, j’ai servi d’interprète à vos officiers qui venaient s’entrainer en Russie soviétique, tester vos nouvelles armes et vos nouvelles tactiques. Nous avons beaucoup appris avec vous. » — « Oui, mais vous n’en avez pas profité. Staline a liquidé tous les officiers qui avaient adopté nos concepts, à commencer par Toukhatchevski. » — « Je regrette beaucoup Toukhatchevski. Personnellement, je veux dire. Politiquement, je ne peux pas juger Staline. Peut-être était-ce une erreur. Les bolcheviques aussi commettent des erreurs. Mais ce qui est important, c’est que nous avons la force de purger régulièrement nos propres rangs, d’éliminer ceux qui dévient, ceux qui se laissent corrompre. C’est une force qui vous manque : votre Parti pourrit de l’intérieur. — « Chez nous aussi, il y a des problèmes. Au SD, nous le savons mieux que quiconque, et nous travaillons pour rendre le Parti et le Volk meilleurs. Il sourit doucement : « Finalement, nos deux systèmes ne sont pas si différents. Dans le principe du moins. » — « C’est là un propos curieux, pour un communiste. » — « Pas tant que ça, si vous y réfléchissez. Quelle différence, au fond, entre un national-socialisme et le socialisme dans un seul pays ? — « Dans ce cas, pourquoi sommes-nous engagés dans une telle lutte à mort ? — « C’est vous qui [564] l’avez voulu, pas nous. Nous étions prêts à des accommodements. Mais c’est comme autrefois, avec les chrétiens et les Juifs : au lieu de s’unir au Peuple de Dieu avec lequel ils avaient tout en commun, pour former un front commun contre les païens, les chrétiens ont préféré, sans doute par jalousie, se laisser paganiser et se retourner, pour leur malheur contre les témoins de la vérité. C’a été un immense gâchis. — « J’imagine que, dans votre comparaison, les Juifs, c’est vous ? » — « Bien entendu. Après tout, vous nous avez tout pris, même si ce n’était qu’en caricaturant. Et je ne parle pas que symboles, comme le drapeau rouge et le 1er mai. Je parle des concepts les plus chers à votre Weltanschauung — « Dans quel sens l’entendez-vous ? » Il se mit à compter sur ses doigts, à la manière russe, les repliant un à un en partant du petit doigt : « Là où le Communisme vise une société sans classe vous prêchez la Volksgemeinschaft, ce qui est fond strictement la même chose, réduit à vos frontières. Là où Marx voyait le prolétaire comme le porteur de la vérité, vous avez décidé que la soi-disant race allemande est une race prolétaire, incarnation du Bien et de la moralité ; en conséquence, à la lutte des classes, vous avez substitué la guerre prolétarienne allemande contre les Etats capitalistes. En économie aussi vos idées ne sont que des déformations de nos valeurs. Je connais bien votre économie politique, car avant la guerre je traduisais pour le Parti des articles de vos journaux spécialisés. Là où Marx a posé une théorie de la valeur fondée sur le travail, votre Hitler déclare : Notre mark allemand, qui n’est pas soutenu par l’or, vaut plus que l’or. Cette phrase un peu obscure a été commentée par le bras droit de Goebbels, Dietrich, qui expliquait que le [565] national-socialisme avait compris que la meilleure fondation d’une devise est la confiance dans les forces productives de la Nation et en la direction de l’Etat. Le résultat, c’est que l’argent, pour vous, est devenu un fétiche qui représente le pouvoir productif de votre pays, donc une aberration totale. Vos nations avec vos grands capitalistes sont grossièrement hypocrites, surtout depuis les réformes du ministre Speer : vos responsables continuent à prôner la libre entreprise, mais vos industries sont toutes soumises à un plan et leurs profits sont limitées à 6 %, l’Etat s’appropriant le reste en sus de la production. » Il se tut. « Le national-socialisme a aussi ses déviations », répondis-je enfin. Je lui expliquai brièvement les thèses d’Ohlendorf. Oui, fit-il, je connais bien ses articles. Mais lui aussi se fourvoie. Parce que vous n’avez pas imité le marxisme, vous l’avez perverti. La substitution de la race à la classe, qui mène à votre racisme prolétaire, est un non-sens absurde. » — « Pas plus que votre notion de la guerre des classes perpétuelle. Les classes sont une donnée historique ; elles sont apparues à un certain moment et disparaitront de même, en se fondant harmonieusement dans la Volksgemeinschaft au lieu de s’étriper. Tandis que la race est une donnée biologique, naturelle, et donc incontournable. Il leva la main : « Ecoutez, je n’insisterai pas là-dessus, car c’est une question de foi et donc les démonstrations logiques, la raison, ne servent à rien. Mais vous pouvez au moins être d’accord avec moi sur un point : même si l’analyse des catégories qui jouent est différente, nos idéologies ont ceci de fondamental en commun, c’est qu’elles sont toutes deux essentiellement déterministes, déterminisme racial pour vous, déterminisme économique pour nous, mais [566] déterminisme quand même. Nous croyons tous deux l’homme ne choisit pas librement son destin, ni qu’il lui est imposé par la nature ou l’histoire. Nous en tirons tous les deux la conclusion qu’il existe des ennemis objectifs, que certaines catégories d’êtres humains peuvent et doivent légitimement être éliminées non pas pour ce qu’elles ont fait ou même pensé, mais pour ce qu’elles sont. En ce nous ne différons que par la définition des catégories : pour vous, les Juifs, les Tsiganes, les Polonais et même je crois savoir les malades mentaux ; pour nous, les koulaks, les bourgeois, les déviationnistes du Parti. Au fond, c’est la même chose ; nous récusons tous deux l’homo œconomicus des capitalistes, l’homme égoïste, individualiste, piégé dans son illusion de liberté, en faveur d’un homo faber : Not a self-made man but a made man, pourrait on dire en anglais, un homme à faire plutôt car l’homme communiste reste à construire, à éduquer tout comme votre parfait national-socialiste. Et cet homme à faire justifie la liquidation impitoyable de tout ce qui est inéducable, et justifie donc le NKVD et la Gestapo, jardiniers du corps social, qui arrachent les mauvaises herbes et forcent les bonnes à suivre leurs tuteurs. » Je lui tendis une autre cigarette et en allumai une pour moi : « Vous avez les idées larges, pour un politrouk2 bolchevique. » Il rit, un peu amèrement : « C’est que mes vieilles relations, allemandes et autres, se sont retrouvées en défaveur. Lorsqu’on est mis à l’écart, cela donne du temps et surtout une perspective pour réfléchir. — « C’est ce qui explique qu’un homme avec votre passé ait un poste somme toute si modeste ? » — « Sans doute. A une époque, voyez-vous, j’étais proche de Radek — mais pas de Trotski, ce qui me [567] vaut d’être encore ici. Mais mon peu d’avancement ne me dérange pas, vous savez. Je n’ai aucune ambition personnelle. Je sers mon Parti et mon pays, et je suis heureux de mourir pour eux. Mais ça n’empêche pas de réfléchir. » — « Mais si vous croyez que nos deux systèmes sont identiques, pourquoi luttez-vous contre nous ? » — « Je n’ai jamais dit qu’ils étaient identiques ! Et vous êtes bien trop intelligent pour avoir compris ça. J’ai cherché à vous montrer que les modes de fonctionnement de nos idéologies se ressemblent. Le contenu, bien entendu, diffère : classe et race. Pour moi, votre national-socialisme est une hérésie du Marxisme. — « En quoi, à votre avis, l’idéologie bolchevique est-elle supérieure à celle du national-socialisme ? — « En ce qu’elle veut le bien de toute l’humanité, alors que la vôtre est égoïste, elle ne veut que le bien des Allemands. N’étant pas allemand, il m’est impossible d’y adhérer, même si je le voulais. » — « Oui, mais si vous étiez né bourgeois, comme moi, il vous serait impossible de devenir bolchevique : vous resteriez, quelles que que soient vos convictions intimes, un ennemi objectif. — « C’est vrai, mais c’est à cause de l’éducation. Un enfant de bourgeois, un petit-enfant de bourgeois, éduqué dès la naissance dans un pays socialiste, sera un vrai, un bon communiste, au-dessus de toute suspicion. Lorsque la société sans classes sera une réalité, toutes les classes seront dissoutes dans le Communisme. En théorie, cela peut être étendu au monde entier, ce qui n’est pas le cas du national-socialisme. » — « En théorie, peut-être. Mais vous ne pouvez pas le prouver, et en réalité vous commettez des crimes atroces au nom de cette utopie. » — « Je ne vous répondrai pas que vos crimes sont pires. Je vous dirai simplement que si [568] nous ne pouvons pas prouver à quelqu’un qui refuse de croire en la vérité du Marxisme le bien-fondé de nos espoirs, nous pouvons et nous allons vous prouver concrètement l’inanité des vôtres. Votre racisme biologique postule que les races sont inégales entre elles, que certaines sont plus fortes et plus valables que d’autres, et que la plus forte et la plus valable de toutes est la race allemande. Mais lorsque Berlin ressemblera à cette ville-ci » — il braqua son doigt vers le plafond — « et lorsque nos braves soldats camperont sur votre Unter den Linden, vous serez au moins obligés, si vous voulez sauver votre foi raciste, de reconnaitre que la race slave est plus forte que la race allemande. » Je ne me laissai pas démonter : « Vous croyez sincèrement, alors que vous avez à peine tenu Stalingrad, que vous allez prendre Berlin ? Vous voulez rire. » — « Je ne le crois pas, je le sais. Il n’y a qu’à regarder les potentiels militaires respectifs. Sans compter le deuxième front que nos alliés vont ouvrir en Europe, bientôt. Vous êtes foutus. — « Nous nous battrons jusqu’à la dernière cartouche. » — « Sans doute, mais vous périrez quand même. Et Stalingrad restera comme le symbole de votre défaite. A tort, d’ailleurs. A mon avis, vous avez déjà perdu la guerre l’année dernière, quand on vous a arrêtés devant Moscou. Nous avons perdu du territoire, des villes, des hommes ; tout cela se remplace. Mais le Parti n’a pas craqué et ça, c’était votre seul espoir. Sans ça, vous auriez même pu prendre Stalingrad, cela n’aurait rien changé. Et vous auriez pu prendre Stalingrad, d’ailleurs, si vous n’aviez pas commis tant d’erreurs, si vous ne nous aviez pas tant sous-estimés. Il n’était pas inévitable que vous perdiez ici, que votre 6ème armée soit entièrement détruite. Mais si vous aviez gagné à Stalingrad, [569] alors quoi ? Nous aurions toujours été à Oulianovsk, à Kouibyshev, à Moscou, à Sverdlovsk. Et nous aurions fini par vous faire la même chose un peu plus loin. Bien sûr, le symbolisme n’aurait pas été le même, ce n’aurait pas été la ville de Staline. Mais qui est Staline au fond ? Et que nous font, à nous bolcheviques, sa démesure et sa gloire ? Pour nous, ici, qui mourons tous les jours, que nous font ses coups de téléphone quotidiens à Joukov ? Ce n’est pas Staline qui donne aux hommes le courage de se ruer devant vos mitrailleuses. Bien sûr, il faut un chef, il faut quelqu’un pour tout coordonner, mais ça aurait pu être n’importe quel autre homme de valeur. Staline n’est pas plus irremplaçable que Lénine, ou que moi. Notre stratégie ici a été une stratégie du bon sens. Et nos soldats, nos bolcheviques auraient montré autant de courage à Kouibyshev. Malgré toutes nos défaites militaires, notre Parti et notre peuple sont restés invaincus. Maintenant, les choses vont aller dans l’autre sens. Les vôtres commencent déjà à évacuer le Caucase. Notre victoire finale ne fait aucun doute. » — « Peut-être , rétorquai-je. Mais à quel prix pour votre Communisme ? Staline, depuis le début de la guerre, fait appel aux valeurs nationales, les seules qui inspirent réellement les hommes, pas aux valeurs communistes. Il a réintroduit les ordres tsaristes de Souvorov et de Koutouzov, ainsi que les épaulettes dorées pour les officiers, qu’en 17 vos camarades de Petrograd leur clouaient aux épaules. Dans les poches de vos morts, même des officiers supérieurs, nous trouvons des icônes cachées. Mieux encore, nous savons par nos interrogatoires que les valeurs raciales se montrent au grand jour dans les plus hautes sphères du Parti et de l’armée, un esprit grand-russien, antisémite, que Staline [570] et les dirigeants du Parti cultivent. Vous aussi, vous commencez à vous méfier de vos Juifs ; pourtant, ce n’est pas une classe. — « Ce que vous dites est certainement vrai, reconnut-il avec politesse. Sous la pression de la guerre, les atavismes remontent à la surface. Mais il ne faut pas oublier ce qu’était le peuple russe avant 1917, son état d’ignorance, d’arriération. Nous n’avons même pas eu vingt ans pour l’éduquer et le corriger, c’est peu. Après la guerre nous reprendrons cette tâche, petit à petit toutes ces erreurs seront corrigées. — « Je crois que vous avez tort. Le problème n’est pas le peuple : ce sont vos dirigeants. Le Communisme est un masque plaqué sur le visage inchangé de la Russie. Votre Staline est un tsar, votre Politburo des boyards ou des nobles avides et égoïstes, vos cadres du Parti les mêmes tchinovniki3 que ceux de Pierre ou de Nicolas. C’est le même autocratisme russe, la même insécurité permanente, la même paranoïa de l’étranger, la même incapacité fondamentale de gouverner correctement, la même substitution de la terreur au consensus commun, et donc au vrai pouvoir, la même corruption effrénée, sous d’autres formes, la même incompétence, la même ivrognerie. Lisez la correspondance de Kourbsky et Ivan, lisez Karamzine, lisez Custine. La donnée centrale de votre histoire n’a jamais été modifiée : l’humiliation, de père en fils. Depuis le début, mais surtout depuis les Mongols, tout vous humilie, et toute la politique de vos gouvernants consiste non pas à corriger cette humiliation et ses causes, mais à la cacher au reste du monde. Le Petersbourg de Pierre n’est rien qu’un autre village à la Potemkine : ce n’est pas une fenêtre ouverte sur l’Europe, mais un décor de théâtre monté pour masquer à [571] l’Occident toute la misère et la crasse sans fin qui s’étalent derrière. Or on ne peut humilier que les humiliables ; et à leur tour, il n’y a que les humiliés qui humilient. Les humiliés de 1917, de Staline au moujik, ne font depuis qu’infliger à d’autres leur peur et leur humiliation. Car dans ce pays d’humiliés, le tsar, quelle que soit sa force, est impuissant, sa volonté se perd dans les marécages bourbeux de son administration, il en est vite réduit, comme Pierre, à ordonner qu’on obéisse à ses ordres ; devant lui, on fait des courbettes, et dans son dos, on le vole ou on complote contre lui ; tous flattent leurs supérieurs et oppriment leurs subordonnés, tous ont une mentalité d’esclaves, de raby comme vous dites, et cet esprit d’esclave monté jusqu’au sommet ; le plus grand esclave de tous, c’est le tsar, qui ne peut rien contre la lâcheté et l’humiliation de son peuple d’esclaves, et qui donc, dans son impuissance, les tue, les terrorise et les humilie encore plus. Et chaque fois qu’il y a une réelle rupture dans votre histoire, une vraie chance de sortir de ce cycle infernal pour commencer une nouvelle histoire, vous la ratez : devant la liberté, cette liberté de 1917 dont vous parliez, tout le monde, le peuple comme les dirigeants, recule et se replie sur les vieux réflexes éprouvés. La fin de la NEP, la déclaration du socialisme dans un seul pays, ce n’est rien d’autre que ça. Et puis comme les espoirs n’étaient pas entièrement éteints, il a fallu les purges. Le grand-russisme actuel n’est que l’aboutissement logique de ce processus. Le Russe, humilié éternel, ne s’en tire jamais que d’une façon, en s’identifiant à la gloire abstraite de la Russie. Il peut travailler quinze heures par jour dans une usine glaciale, ne manger toute sa vie que du pain noir et du chou, et servir un patron grassouillet qui se dit marxiste-léniniste mais qui roule en limousine avec ses poules de luxe et son champagne français, peu lui importe, du moment que la Troisième Rome4 se fera. Et cette Troisième Rome peut s’appeler chrétienne ou communiste, ça n’a aucune importance. Quant au directeur de l’usine tremblera en permanence pour sa place, il flattera son supérieur et lui offrira des cadeaux somptueux et, s’il est déchu, un autre, identique, sera nommé sa place, tout aussi avide, ignare et humilié que lui et méprisant pour ses ouvriers parce que après tout il sert un Etat prolétaire. Un jour, sans doute, la façade communiste disparaitra, avec ou sans violence. Alors on découvrira cette même Russie intacte. Si jamais vous la gagnez, vous sortirez de cette guerre plus nationaux-socialistes et plus impérialistes que nous, mais votre socialisme, à la différence du nôtre, ne sera qu’un nom vide, et il ne vous restera que le nationalisme auquel vous raccrocher. En Allemagne, et dans les pays capitalistes, on affirme que le Communisme a ruiné la Russie ; moi, je crois le contraire : c’est la Russie qui a ruiné le Communisme. C’aurait pu être une belle idée, et qui peut dire ce qui serait advenu si la Révolution s’était faite en Allemagne plutôt qu’en Russie ? Si elle avait été menée par des Allemands sûrs d’eux, comme vos amis Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht ? Pour ma part, je pense que cela aurait été un désastre, car cela aurait exacerbé nos conflits spécifiques, que le national-socialisme cherche à résoudre. Mais qui sait ? Ce qui est sûr, c’est qu’ayant été tentée ici, l’expérience communiste ne pouvait être qu’un échec. C’est comme une expérience médicale menée en milieu contaminé : les résultats sont bons à jeter. » — « Vous êtes un excellent dialecticien, et je [573] vous félicite, on dirait que vous êtes passé par une formation communiste. Mais je suis fatigué et je ne vais pas me disputer avec vous. De toute façon, tout cela n’est que des mots. Ni vous ni moi ne verrons le futur que vous décrivez. » — « Qui sait ? Vous êtes un commissaire de haut rang. Peut-être allons-nous vous envoyer dans un camp pour vous interroger. » — « Ne vous moquez pas de moi, répliqua-t-il durement. Les places, dans vos avions, sont bien trop limitées pour que vous évacuiez un petit poisson. Je sais parfaitement que je serai fusillé, tout à l’heure ou demain. Cela ne me dérange pas. » Il reprit un ton enjoué : « Connaissez-vous l’écrivain français Stendhal ? Alors, vous aurez certainement lu cette phrase : Je ne vois que la condamnation à mort qui distingue un homme. C’est la seule chose qui ne s’achète pas. » Je fus pris d’un ricanement irrésistible ; lui aussi riait, mais plus doucement. « Mais où donc êtes-vous allé pêcher ça » articulai-je enfin. Il haussa les épaules : « Oh. Je n’ai pas lu que Marx, vous savez. — « C’est dommage que je n’aie rien à boire, dis-je. Je vous aurais volontiers offert un verre. Je redevins sérieux : « C’est dommage aussi que nous soyons ennemis. Dans d’autres circonstances, nous aurions pu nous entendre. » — « Peut-être, fit-il pensivement, mais peut-être que non. Je me levai, allai à la porte, et appelai l’Ukrainien. Puis je retournai derrière mon bureau. Le commissaire s’était levé et tentait de redresser sa manche déchirée. Toujours debout, je lui offris le reste de mon paquet de cigarettes. « Ah, merci, dit-il. Vous avez des allumettes ? » Je lui donnai aussi la boite d’allumettes. L’Ukrainien attendait sur le pas de la porte. « Permettez-moi de ne pas vous serrer la main », dit le commissaire avec un petit sourire ironique.
Sarabande
De retour à Berlin après avoir échappé miraculeusement à la mort qu’aurait dû lui causer une balle dans la tête, Aue se remet de sa blessure et cherche un poste dans la diplomatie, en France, quand lors d’une visite au Dr. Mandelbrod, un ancien directeur de son père, il se voit proposer un rôle important dans l’organisation du travail des Juifs.
« Les Juifs sont les premiers vrais nationaux-socialistes, depuis près de trois mille cinq cents ans déjà » (p. 649-653)
[649] En Allemagne, [dit le Dr. Mandelbrod], ton père fut parmi les premiers à comprendre qu’il fallait un rôle égal, avec un respect mutuel, pour tous les membres de la nation, mais seulement au sein de la nation. A leur manière, toutes les grandes sociétés de l’histoire ont été nationales et socialistes. Regarde Temüdjin, l’exclu : ce n’est que lorsqu’il a pu imposer cette idée-là, et unifier les tribus sur cette base, que les Mongols ont pu conquérir le monde, au nom de ce déclassé devenu Empereur Océanique, Gengis Khan. J’ai fait lire au Reichsführer un livre sur lui, il en a été très impressionné. Avec une immense et féroce sagesse, les Mongols ont tout rasé devant eux, pour reconstruire ensuite sur des bases saines. Toute l’infrastructure de l’Empire russe, toutes les fondations sur lesquelles les Allemands ont ensuite bâti, chez eux, sous des tsars de fait aussi allemands, ce sont les Mongols qui les leur ont apportées : les routes, l’argent, la poste, les douanes, l’administration. Ce n’est que lorsque les Mongols ont compromis leur pureté, en prenant génération après génération des femmes étrangères, souvent d’ailleurs parmi les nestoriens, c’est-à-dire les plus juifs des [650] chrétiens, que leur empire s’est dissous et effondré. Les Chinois présentent un cas contraire mais également instructif : ils ne sortent pas de leur Empire du Milieu, mais absorbent et sinisent irrémédiablement tout peuple qui y entre, aussi puissant soit-il, ils le noient dans un océan sans bornes de sang chinois. Ils sont très forts. D’ailleurs, lorsque nous en aurons fini avec les Russes, nous aurons toujours les Chinois devant nous. Les Japonais ne leur résisteront jamais, même s’ils ont l’air de tenir le haut du pavé aujourd’hui. Si ce n’est pas tout de suite, toute façon il faudra se confronter à eux un jour, dans cent, deux cents ans. Autant alors les garder faibles, les empêcher si possible de comprendre le national-socialisme et de l’appliquer à leur propre situation. Sais-tu, d’ailleurs, que le terme même de « national-socialisme » a été forgé par un Juif, un précurseur du sionisme, Moïse Hess ? Lis son livre, un jour, Rome et Jérusalem, tu verras. C’est très instructif. Et ce n’est pas un hasard : quoi de plus völkisch que le Sionisme ? Comme nous, ils ont reconnu qu’il ne peut y avoir de Volk et de Blut sans Boden, sans terre, et donc qu’il faut ramener les Juifs à la terre, Eretz Israël pure de toute autre race. Bien sûr, ce sont d’anciennes idées juives. Les Juifs sont les premiers vrais nationaux-socialistes, depuis près de trois mille cinq cents ans déjà, depuis que Moïse leur a donné une Loi pour les séparer à jamais des autres peuples. Toutes nos grandes idées viennent des Juifs et nous devons avoir la lucidité de le reconnaître : la Terre comme promesse et comme accomplissement, la notion du peuple choisi entre tous, le concept de la pureté du sang. C’est pour cela que les Grecs, abâtardis, démocrates, voyageurs, cosmopolites, les haïssaient tant, et c’est pour cela qu’ils ont d’abord [651] essayé de les détruire, puis, par le biais de Paul, de les corrompre leur religion de l’intérieur, en la détachant du sol et du sang, en la rendant catholique, c’est-à-dire universelle, en supprimant toutes les lois qui servaient de barrière pour maintenir la pureté du sang juif : les interdits alimentaires, la circoncision. Et c’est donc pour cela que les Juifs sont, de tous nos ennemis, les pires de tous, les plus dangereux ; les seuls qui valent vraiment la peine d’être haïs. Ce sont nos seuls vrais concurrents, en fait. Nos seuls rivaux sérieux. Les Russes sont faibles, une horde privée de centre malgré les tentatives de ce Géorgien arrogant de leur imposer un « national-communisme ». Et les insulaires, britanniques ou américains, sont pourris, gangrenés, corrompus. Mais les Juifs ! Qui donc, à l’époque scientifique, a redécouvert, en se fondant sur l’intuition millénaire de son peuple, humilié mais invaincu, la vérité de la race ? Benjamin Disraeli, un Juif. Gobineau a tout appris chez lui. Tu ne me crois pas ? Va voir. » Il désigna les étagères à côté de son bureau : « Là, va voir. » Je me levai de nouveau et allai aux étagères : plusieurs livres de Disraeli y côtoyaient ceux de Gobineau, Vacher de Lapouge, Drumont, Chamberlain, Herzl, et d’autres encore. « Lequel, Herr Doktor ? Il y en a plusieurs. » — « N’importe, n’importe. Ils disent tous la même chose. Prends Coningsby, tiens. Tu lis l’anglais, n’est-ce pas ? Page 203. Commence avec But Sidonia and his brethren… Lis à haute voix. » Je trouvais le passage et lus : « Mais Sidonia et ses frères pouvaient se réclamer d’une distinction que le Saxon et le Grec, et le reste des nations caucasiennes, avaient abandonnée. L’Hébreu est une race sans mélanges… Une race sans mélanges, d’une organisation de première classe, est l’aristocratie de la Nature. » — « Très bien ! Page 231, maintenant. The fact is, you cannot destroy… Il parle des Juifs sûr. » — « Oui. Le fait est qu’on ne peut détruire une pure race d’organisation caucasienne. C’est un fait physiologique ; une simple loi de la nature, qui a mis en échec les rois égyptiens et assyriens, les empereurs romains, et les inquisiteurs chrétiens. Aucune loi pénale, aucune torture physique, ne peut faire qu’une race supérieure soit absorbée par une inférieure, ou détruite par elle. Les races persécutrices mélangées disparaissent ; la pure race persécutée demeure » — « Voilà ! Songe que cet homme, ce Juif a été premier ministre de la reine Victoria ! Qu’il a fondé l’Empire britannique ! Lui qui, encore inconnu, avançait des thèses pareilles devant un Parlement chrétien ! Reviens ici. Sers-moi du thé, tiens. Je revins près de lui et lui versai une autre tasse. « Par amour et par respect pour ton père, Max, je t’ai aidé, j’ai suivi ta carrière, je t’ai soutenu quand je l’ai pu. Tu te dois de lui faire honneur, et à sa race et à la tienne. Il n’y a pas de place sur cette terre que pour un seul peuple choisi, appelé à dominer les autres : ou ce sera eux, comme le veulent le Juif Disraeli et le Juif Herzl, ou ce sera nous. Et nous devons donc les abattre jusqu’au dernier, extirper leur souche. Car qu’il n’en reste que dix, un quorum intact, qu’il n’en reste que deux, un homme et une femme, dans cent ans nous aurons le même problème, et tout sera à refaire. »
Menuet (en rondeaux)
Prenant à cœur la tâche qu’il a finalement accepté, celle de fournir à l’Allemagne des travailleurs juifs en en rationalisant le coût, Aue est alors confronté à la réalité des camps d’extermination qui ne furent que l’industrialisation de dont il avait été le témoin en Ukraine (cf. le premier extrait) et rencontrent régulièrement un Eichmann attaché par rigueur professionnelle à envoyer ses travailleurs à la mort. Pendant ce temps, l’Allemagne perd tout doucement la guerre et face au spectre de la défaite, la propagande totalitaire ne parvient plus à masquer les contradictions du régime, ni à camoufler la débâcle.
« Nous devons servir le »Volk » comme le sert le Führer, avec une abnégation totale » ; Eichmann à Berlin (p. 806-814)
[806] Frau Eichmann servait des gâteaux et du thé ; Günther arriva, prit une tasse, et se posta dans coin pour la boire, sans parler avec qui que ce soit. Je l’observais à la dérobée tandis que les autres discutaient. C’était un homme visiblement très jaloux de son maintien opaque et fermé, qu’il dressait devant ses collègues plus bavards comme un reproche muet. On le disait fils de Hans F. K. Günther, le doyen de l’anthropologie raciale allemande dont l’œuvre avait alors une influence immense ; si c’était vrai, celui-ci pouvait être fier de son rejeton, passé de la théorie à la mise en œuvre. Il s’éclipsa en disant distraitement au revoir au bout d’une petite demi-heure. On passait à la musique : « Toujours avant le diner, me signifia Eichmann. Après, on est trop occupé à digérer pour bien jouer. » Vera Eichmann se mit à l’alto et un autre officier déballa un violoncelle. Ils jouèrent deux des trois quatuors à cordes de Brahms, agréables, mais de peu d’intérêt pour mon goût ; l’exécution était convenable, sans grandes surprises : seul le violoncelliste avait un talent particulier. Eichmann jouait posément, méthodiquement, les yeux rivés à sa partition; il ne faisait pas de fautes, mais ne semblait pas comprendre que cela ne suffisait pas. Je me rappelai alors son commentaire de l’avant-veille : « Boll joue [807] mieux que moi et Heydrich jouait mieux encore. » Peut-être qu’après tout il le comprenait, et acceptait ses limites, tirant du plaisir du peu auquel il parvenait.
J’applaudis vigoureusement ; Frau Eichmann en sembla particulièrement flattée. « Je vais coucher les enfants, dit-elle. Ensuite, nous passerons à table. » Nous reprîmes un verre en l’attendant : les femmes parlaient du rationnement ou des rumeurs, les hommes des dernières nouvelles, peu intéressantes, car le front restait stable et il ne s’était rien passé depuis la chute de Tunis. L’ambiance était informelle, gemütlich à l’autrichienne, un rien exagérée. Puis Eichmann nous invita à passer dans la salle à manger. Il désigna lui-même les places, me mettant à sa droite, à la tête de la table. Il déboucha quelques bouteilles de vin du Rhin et Vera Eichmann apporta un rôti avec une sauce aux baies et des haricots verts. Cela me changeait de la cuisine immangeable de Frau Gutknecht et même de la cantine ordinaire de la SS-Haus. « Délicieux, complimentai-je Frau Eichmann. Vous êtes une cuisinière hors pair. » — « Oh, j’ai de la chance. Dolfi arrive souvent à trouver des denrées rares. Les magasins sont presque vides. Inspiré, je me laissai aller à un portrait à charge de ma logeuse, commençant par sa cuisine puis dérivant sur d’autres traits. « Stalingrad ? faisais-je en imitant son patois et sa voix. Mais qu’est-ce que vous êtes bien allés foutre là-bas ? On n’est pas bien, ici ? Et puis c’est où, d’abord ? » Eichmann riait et s’étranglait avec son vin. Je continuais : « Un jour, le matin, je sors en même temps qu’elle. On voit passer un porteur d’étoile, sans doute un Mischling privilégié. Elle qui s’exclame : Oh ! Regardez, Herr Offizier, un Juif ! Vous l’avez pas encore [808] gazé celui-là ? » Tout le monde riait. (…) Je versai du vin à Eichmann : « Buvez, allez. » Il riait encore. La conversation prenait un autre tour et je mangeai ; un des convives racontait une histoire drôle sur Goering. Eichmann prit un air grave et se tourna vers moi : « Sturmbannführer Aue, vous avez fait des études. Je voudrais vous poser une question, une question sérieuse. » Je lui fis signe avec ma fourchette de continuer. « Vous avez lu Kant, je suppose ? En ce moment, poursuivit-il en se frottant les lèvres, je lis la Critique de la raison pratique. Bien entendu, un homme comme moi, sans formation universitaire je veux dire, ne peut pas tout comprendre. Néanmoins on peut comprendre certaines choses. Et j’ai beaucoup réfléchi, surtout, à la question de l’Impératif kantien. Vous êtes, j’en suis sûr, d’accord avec moi pour dire que tout homme honnête doit vivre selon cet impératif. « Je bus une gorgée de vin et acquiesçai. Eichmann continuait : « L’Impératif, tel que je le comprends, dit : Le principe de ma volonté individuelle doit être tel qu’il puisse devenir le principe la Loi morale. En agissant, l’homme légifère. » Je m’essuyai la bouche : « Je crois voir où vous voulez en venir. Vous vous demandez si notre travail s’accorde avec l’Impératif kantien. » — « Ce n’est pas tout à fait ça. Mais un de mes amis, qui lui aussi s’intéresse à ce genre de questions, affirme qu’en temps de guerre, en vertu si vous voulez de l’état d’exception causé par le danger, l’Impératif kantien est suspendu, car bien entendu, ce que l’on souhaite [809] faire à l’ennemi, on ne souhaite pas que l’ennemi nous le fasse, et donc ce que l’on fait ne peut pas devenir la base d’une loi générale. C’est son avis, vous voyez bien. Or moi, je sens qu’il a tort, et qu’en fait par notre fidélité au devoir, en quelque sorte, par obéissance aux ordres supérieurs… que justement il faut mettre notre volonté à mieux remplir les ordres. A les vivre de manière positive. Mais je n’ai pus encore trouvé l’argument imparable pour lui prouver qu’il a tort. » — « Pourtant, c’est assez simple, je pense. Nous sommes tous d’accord que dans un Etat national-socialiste le fondement ultime de la loi positive est la volonté du Führer. C’est le principe bien connu Führerworte haben Gesetzeskraft. Bien entendu, nous reconnaissons qu’en pratique le Führer ne peut pas s’occuper de tout et que donc d’autres doivent aussi agir et légiférer en son nom. En principe, cette idée devrait être étendue au Volk entier. C’est ainsi que le Dr. Frank, dans son traité sur le droit constitutionnel, a étendu la définition du Führerprinzip de la manière suivante : Agissez de manière que le Führer, s’il connaissait votre action, l’approuverait. Il n’y a aucune contradiction entre ce principe et l’Impératif de Kant. » — « Je vois, je vois. Frei sein ist Knecht sein, Être libre, c’est être un vassal, comme dit le vieux proverbe allemand. — « Précisément. Ce principe est applicable à tout membre de la Volksgemeinschaft. Il faut vivre son national-socialisme en vivant sa propre volonté comme celle du Führer et donc, pour reprendre les termes de Kant, comme fondement de la Volksrecht. Celui qui ne fait qu’obéir aux ordres comme une mécanique, sans les examiner de manière critique pour en pénétrer la nécessité intime, ne travaille pas en direction du Führer; la plupart du temps, il s’en [810] éloigne. Bien entendu, le principe même du droit constitutionnel völkisch est le Volk : il ne s’applique pas en dehors du Volk. L’erreur de votre ami, c’est de faire appel à un droit supranational entièrement mythique, une invention aberrante de la Révolution française. Tout droit doit reposer sur un fondement. Historiquement, celui-ci a toujours été une fiction, ou une abstraction, Dieu, le Roi ou le Peuple. Notre grande avancée a été de fonder le concept juridique de la Nation sur quelque chose de concret et d’inaliénable : le Volk, dont la volonté collective s’exprime par le Führer qui le représente. Quand vous dites Frei sein ist Knecht sein, il faut comprendre que le premier vassal de tous, c’est précisément le Führer car il n’est rien d’autre que pur service. Nous ne servons pas le Führer en tant que tel mais en tant que représentant du Volk, nous servons le Volk et devons le servir comme le sert le Führer, avec une abnégation totale. C’est pourquoi, confronté à des tâches douloureuses, il faut s’incliner, maitriser ses sentiments, et les accomplir avec fermeté. » Eichmann écoutait de manière attentive, le cou tendu, les yeux fixes derrière ses grosses lunettes. « Oui, oui, dit-il avec chaleur, je vous comprends tout à fait. Notre devoir, notre accomplissement du devoir, c’est la plus haute expression de notre liberté humaine. — « Absolument. Si notre volonté est de servir notre Führer et notre Volk, alors, par définition, nous sommes aussi porteurs du principe de la loi du Volk, telle qu’elle est exprimée par le Führer ou dérivée de sa volonté. » — « Excusez-moi, intervint un des commensaux, mais Kant de toute façon n’était-il antisémite ? » — « Certes, répondis-je. Mais son antisémitisme restait purement religieux, tributaire de sa croyance en la vie future. Ce sont là des [811] conceptions que nous avons largement dépassées. » Frau Eichmann, aidée d’une des invitées, débarrassait la table. Eichmann servait du schnaps et allumait une cigarette. Pendant quelques minutes, le bavardage reprit. Je bus mon schnaps et fumai aussi. Frau Eichmann servit du café. Eichmann me fit signe : « Venez avec moi. Je veux vous montrer quelque chose. » Je le suivis dans sa chambre à coucher. Il alluma la lumière, m’indiqua une chaise, tira une clef de sa poche, et, tandis que je m’asseyais, il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un album assez épais relié en cuir noir granulé. Les yeux brillants, il me le tendit et s’assit sur le lit. Je le feuilletai : il s’agissait d’une série de rapports, certains sur papier bristol, d’autres sur papier ordinaire, et de photographies, le tout relié en un album comme celui que j’avais conçu à Kiev après la Grosse Aktion5. La page de titre, calligraphiée en lettres gothiques, annonçait : LE QUARTIER JUIF DE VARSOVIE N’EXISTE PLUS ! « Qu’est-ce que c’est ? » demandai-je. — « Ce sont les rapports du Brigadeführer Stroop sur la répression du soulèvement juif. Il a offert cet album au Reichsführer, qui me l’a communiqué pour que je l’étudie. » Il en rayonnait de fierté. Regardez, regardez, c’est étonnant. » J’examinai les clichés : il y en avait d’impressionnants. Des bunkers fortifiés, des immeubles incendiés, des Juifs sautant des toits pour échapper aux flammes ; puis les décombres du quartier après la bataille. La Waffen-SS et les forces auxiliaires avaient du réduire les poches de résistance à l’artillerie, à bout portant. » — « Ça a duré presque un mois, chuchota Eichmann en se mordillant une cuticule. Un mois ! Avec plus de six bataillons. Regardez au début, la liste des pertes. » La première page dénombrait seize morts, [812] dont un policier polonais. Suivait une longue liste de blessés. « Qu’est-ce qu’ils avaient comme arme » demandai-je. — « Pas grand-chose, heureusement. Quelques mitrailleuses, des grenades et des pistolets, des bouteilles incendiaires. » — « Comment est-ce qu’ils les ont obtenus ? » — « Sans doute auprès des partisans polonais. Ils se sont battus comme des loups, vous avez vu ? Des Juifs affamés depuis trois ans. Les Waffen-SS étaient choqués. » C’était presque la même réaction que Thomas, mais Eichmann semblait plus effrayé qu’admiratif. « Le Brigadeführer Stroop affirme que même les femmes cachaient des grenades sous leurs jupes pour se faire sauter avec un Allemand lorsqu’elles se rendaient. » — « C’est compréhensible, fis-je. Elles savaient ce qui les attendait. Le quartier a été entièrement vidé ? — « Oui. Tous les Juifs pris vivants ont été dirigés sur Treblinka. C’est un des centres dirigé par le Gruppenführer Globocnik. » — « Sans sélection. » — « Bien sûr ! Beaucoup trop dangereux. Vous savez, encore une fois, c’est l’Obergruppenführer Heydrich qui avait raison. Il comparait cela à une maladie : c’est toujours le résidu final qui est le plus difficile à détruire. Les faibles, les vieux disparaissent tout de suite ; à la fin, il ne reste plus que les jeunes, les forts, les rusés. C’est très inquiétant, parce que c’est le produit de la sélection naturelle, le vivier biologique le plus fort : si ceux-là survivent, dans cinquante ans tout est à recommencer. Je vous ai déjà expliqué que ce soulèvement nous a beaucoup inquiétés. Si cela se reproduit, ce pourrait être une catastrophe. Il ne faut leur laisser aucune opportunité. Imaginez une pareille révolte dans un camp de concentration ! Impensable. » — « Pourtant, il nous faut des travailleurs, vous le savez bien. » [813] — « Bien sûr, ce n’est pas moi qui décide. Je voulais simplement souligner les risques. La question du travail, je vous l’ai déjà dit, ce n’est pas du tout mon domaine, et chacun a ses idées. Mais bon : comme le dit souvent l’Amtschef, on ne peut pas raboter une planche sans que les éclats volent. C’est tout ce que je veux dire. » Je lui rendis l’album. « Merci de m’avoir montré cela, c’était très intéressant. » Nous rejoignîmes les autres ; déjà, les premiers invités prenaient congé. Eichmann me retint pour un dernier verre, puis je m’excusai en remerciant Frau Eichmann et en lui baisant la main. Dans le couloir d’entrée, Eichmann me donna une tape amicale dans le dos : « Permettez-moi, Sturmbanriführer, vous êtes un type bien. Pas un de ces aristos en gants de daim du SD. Non, vous êtes réglo. » Il devait avoir un peu trop bu, ça le rendait sentimental. Je le remerciai et lui serrai la main, le laissant sur le pas de sa porte, les mains dans les poches, souriant d’un côté de la bouche.
Si j’ai décrit si longuement ces rencontres avec Eichmann, ce n’est pas que je m’en souvienne mieux que d’autres : mais ce petit Obersturmbannfuhrer, entre-temps, est devenu en quelque sorte une célébrité et je pensais que mes souvenirs, éclairant son personnage, pourraient intéresser le public. On a écrit beaucoup de bêtises sur lui : ce n’était certainement pas l’ »ennemi du genre humain » qu’on a décrit à Nuremberg (comme il n’était pas là, c’était facile de tout lui mettre sur le dos, d’autant que les juges comprenaient peu de chose au fonctionnement de nos services); il n’était pas non plus une incarnation du mal banal6, un robot (…) sans visage, comme on a voulu le présenter après son procès. C’était un bureaucrate de grand talent, extrêmement [814] compétent dans ses fonctions, avec une envergure certaine et un sens de l’initiative personnelle considérable, mais uniquement dans le cadre de tâches délimitées : dans un poste à responsabilité, où il aurait dû prendre des décisions, à la place de son Amtschef Müller par exemple, il aurait été perdu ; mais comme cadre moyen il aurait fait la fierté de n’importe quelle entreprise européenne. Je n’ai jamais vu qu’il nourrissait une haine particulière envers les Juifs : simplement, il avait bâti sa carrière là-dessus, c’était devenu non seulement sa spécialité mais en quelque sorte son fonds de commerce, plus tard, lorsqu’on voulut le lui ôter, il l’a défendu jalousement, ce qui se comprend. Mais il aurait tout aussi bien pu faire autre chose, et lorsqu’il dit à ses juges qu’il pensait que l’extermination des Juifs était une erreur, on peut le croire ; beaucoup, au RSHA et surtout au SD, pensaient de même, je l’ai déjà montré ; mais une fois la décision prise, il fallait la mener à bien, de cela il était très conscient ; de plus, sa carrière en dépendait. Ce n’était certes pas le genre de personne que j’aimais fréquenter, sa capacité à penser par lui-même était des plus limitées, et en rentrant chez moi, ce soir-là, je me demandais pourquoi j’avais été si expansif, pourquoi j’étais rentré si facilement dans cette ambiance familiale et sentimentale qui d’habitude me répugne tant. Peut-être que moi aussi, j’avais un peu besoin de me sentir appartenir à quelque chose. Lui, son intérêt était clair, j’étais un allié potentiel dans une sphère élevée où il n’aurait normalement eu aucun accès. Mais malgré toute sa cordialité je savais que je restais pour lui un étranger à son département, et donc une menace potentielle pour ses compétences. Et je pressentais qu’il affronterait avec ruse et obstination [815] tout obstacle à ce qu’il considérait être son objectif, qu’il n’était pas homme à se laisser facilement contrer. Je comprenais bien ses appréhensions, face au danger posé par des concentrations de Juifs : mais pour moi ce danger, s’il le fallait, pouvait être minimisé, il fallait simplement y réfléchir et prendre les mesures adéquates. Pour le moment, je gardais un esprit ouvert, je n’étais arrivé à aucune conclusion, je réservais mon jugement jusqu’à ce que mon analyse soit achevée.
Et l’Impératif kantien ? A vrai dire, je n’en savais trop rien, j’avais raconté un peu n’importe quoi à ce pauvre Eichmann. En Ukraine ou au Caucase, des questions de cet ordre me concernaient encore, je m’affligeais des difficultés et en discutais avec sérieux, avec le sentiment qu’il s’agissait là de problèmes vitaux. Mais ce sentiment semblait s’être perdu. Où cela, à quel moment ? A Stalingrad ? Ou après ? J’avais cru un moment sombrer, submergé par les histoires remontées du fond de mon passé. Et puis, avec la mort stupide et incompréhensible de ma mère, ces angoisses aussi avaient disparu : le sentiment qui me dominait à présent était une vaste indifférence, non pas morne, mais légère et précise. Mon travail seul m’engageait, je sentais qu’on m’avait proposé là un défi stimulant qui ferait appel à toutes mes capacités, et je souhaitais réussir — non pas en vue d’un avancement, ou d’ambitions ultérieures, je n’en avais aucune, mais simplement pour jouir de la satisfaction de la chose bien faite.
« L’inhumain, excusez-moi, cela n’existe pas. Il n’y a que de l’humain et encore de l’humain » (p. 840-848)
[840] Un jour je me pris à discuter avec un homme en uniforme d’Untersturmführer, accoudé au bar devant une chope de bière. Döll, c’est ainsi qu’il se nommait semblait flatté qu’un officier supérieur le traite aussi familièrement ; pourtant, il avait bien dix ans de plus que moi. (…) « Moi aussi, j’étais là, entre Kharkov et Koursk. Opérations spéciales. » — « Vous n’étiez pas avec l’Einsatzgruppe, pourtant ? — Non, il s’agissait d’autre chose. En fait, je ne suis pas à la SS. C’était un de ces fameux fonctionnaires de la chancellerie du Führer. « Entre nous, on dit T-4. C’est comme ça que ça s’appelle. — « Et qu’est-ce que vous faisiez du cote de Kharkov ? — « Vous savez, j’étais à Sonnenstein, un des centres pour les malades, là… » Je fis un signe de tête pour indiquer que je savais de quoi il parlait et il continua. « A l’été 41, on a fermé. Et une partie d’entre nous, on était considéré comme des spécialistes, ils ont voulu nous garder, et ils nous ont envoyés en Russie. On était toute une délégation, c’était l’Oberdienstleiter Brack lui-même qui commandait, il y avait les médecins de l’hôpital, tout, et voilà, on menait des actions spéciales. Avec des camions à gaz. On avait chacun une notice spéciale dans notre livre de paie, un papier rouge signé par l’OKW, qui interdisait qu’on soit envoyé trop près du front : ils avaient peur qu’on tombe aux mains des Russes. » — « Je ne comprends pas très bien. Les mesures spéciales, dans cette région, toutes les mesures de SP, c’était la responsabilité de mon Kommando. Vous dites que vous aviez des camions à gaz, mais comment [841] pouviez-vous être chargés des mêmes tâches que nous sans qu’on le sache ? Son visage prit un aspect hargneux, presque cynique : « On n’était pas chargés des mêmes tâches. Les Juifs ou les bolcheviques, là-bas, on n’y touchait pas. » — « Alors ? » Il hésita et but encore, à longs traits, puis essuya, du dos des doigts, la mousse de sa lèvre. « Nous, on s’occupait des blessés. » — « Des blessés russes ? » — « Vous ne comprenez pas. De nos blessés. Ceux qui étaient trop amochés pour avoir une vie utile, on nous les envoyait. » Je compris et il sourit quand il le vit : il avait produit son effet. Je me tournai vers le bar et commandai une autre tournée. « Vous parlez de blessés allemands », fis-je enfin doucement. — « Comme je vous le dis. Une vraie saloperie. Des types comme vous et moi, qui avaient tout donné pour, la Heimat, et crac ! Voilà comment on les remerciait. Je peux vous le dire, j’étais content quand on m’a envoyé ici. C’est pas très gai non plus, mais au moins c’est pas ça. » Nos verres arrivaient. Il me parla de sa jeunesse : il avait fait une école technique, il voulait être fermier, mais avec la crise était entré dans la police : « Mes enfants avaient faim, c’était le seul moyen d’être sûr de pouvoir mettre une assiette sur la table tous les jours. » Fin 1939, il avait été affecté à Sonnenstein pour l’Einsatz Euthanasie. II ne savait pas comment on l’avait choisi. « D’un côté, c’était pas très agréable. Mais de l’autre, ça m’évitait le front, puis la paie était correcte, ma femme était contente. Alors j’ai rien dit. » — « Et Sobibor ? » C’était là, il me l’avait déjà dit, qu’il travaillait actuellement. Il haussa les épaules : « Sobibor ? C’est comme tout, on s’y habitue. » Il eut un geste étrange, qui m’impressionna fortement : du bout de sa botte, il frotta le plancher, comme s’il [842] écrasait quelque chose. « Des petits hommes et des petites femmes, c’est tout pareil. C’est comme marcher sur un cafard ».
On a beaucoup parlé, après la guerre, pour essayer d’expliquer ce qui s’était passé, de l’inhumain. Mais l’inhumain, excusez-moi, cela n’existe pas. Il n’y que de l’humain et encore de l’humain : et ce Döll en est un bon exemple. Qu’est-ce que c’est d’autre, Döll, qu’un bon père de famille qui voulait nourrir ses enfants, et qui obéissait à son gouvernement, même si en son for intérieur il n’était pas tout à fait d’accord ? S’il était né en France ou en Amérique, on l’aurait appelé un pilier de sa communauté et un patriote ; mais il est né en Allemagne, c’est donc un criminel. La nécessité, les Grecs le savaient déjà, est une déesse non seulement aveugle, mais cruelle. Ce n’était pas que les criminels manquaient, à cette époque. Tout Lublin, j’ai essayé de le montrer, baignait dans une atmosphère louche de corruption et d’excès ; l’Einsatz, mais aussi la colonisation, l’exploitation de cette région isolée, faisaient perdre la tête à plus d’un. J’ai réfléchi, depuis les remarques à ce sujet de mon ami Voss, à la différence entre le colonialisme allemand, tel qu’il a été pratiqué à l’Est durant ces années, et le colonialisme des Britanniques et des Français, ostensiblement plus civilisé. Il y a, comme l’avait souligné Voss, des faits objectifs : après la perte de ses colonies, en 1919, l’Allemagne a dû rappeler ses cadres et fermer ses bureaux d’administration coloniale ; les écoles de formation sont restées ouvertes, par principe, mais n’attiraient personne, par manque de débouchés ; [843] vingt ans plus tard, tout un savoir-faire était perdu. Cela étant, le national-socialisme avait donné l’impulsion à toute une génération, bourrée de nouvelles idées et avide de nouvelles expériences, qui, en matière de colonisation, valaient peut-être les anciennes. Quant aux excès — les débordements aberrants comme ceux qu’on pouvait voir à la Deutsches Haus, ou, plus systématiquement, l’impossibilité dans laquelle nos administrations semblaient se trouver de traiter les peuples colonisés, dont certains auraient été prêts à nous servir de bon cœur si l’on avait su leur donner quelques gages, autrement qu’avec violence et mépris — il ne faut pas oublier non plus que notre colonialisme, même africain, était un phénomène jeune, et que les autres, à leurs débuts, n’ont guère fait mieux : que l’on songe aux copieuses exterminations belges au Congo, à leur politique de mutilation systématique, ou bien à la politique américaine, précurseur et modèle de la nôtre, de la création d’espace vital par le meurtre et les déplacements forcés — l’Amérique, on tend à l’oublier, n’était rien moins qu’un « espace vierge » mais les Américains ont réussi là où nous avons échoué, ce qui fait toute la différence. Même les Anglais, si souvent cités en exemple, et qu’admirait tant Voss, ont eu besoin du traumatisme de 1858 pour se mettre à développer des outils de contrôle un peu sophistiqués ; et si, petit a petit, ils ont appris à jouer en virtuoses de l’alternance de la carotte et du bâton, il ne faut pas oublier que le bâton, justement, était loin d’être négligé, comme on a pu le voir avec le massacre d’Amritsar, le bombardement de Kaboul, et d’autres cas encore, nombreux et oubliés. Me voilà loin de mes premières réflexions. Ce que je souhaitais dire, c’est que si l’homme n’est [844] certainement pas, comme l’ont voulu certains poètes et philosophes, naturellement bon, il n’en est pas plus naturellement mauvais : le bien et le mal sont des catégories qui peuvent servir à qualifier l’effet des actions d’un homme sur un autre ; mais elles sont à mon avis foncièrement inadaptées, voire inutilisables, pour juger ce qui se passe dans le cœur de cet homme. Döll tuait ou faisait tuer des gens, c’est donc le Mal ; mais en soi, c’était un homme bon envers ses proches, indifférent envers les autres, et qui plus est respectueux des lois. Que demande-t-on de plus au quidam de nos villes, civilisées et démocratiques ? Et combien de philanthropes, de par le monde, rendus célèbres par leur générosité extravagante, sont-ils au contraire des monstres d’égoïsme et de sécheresse, avides de gloire publique, bouffis de vanité, tyranniques envers leurs proches ? Tout homme désire satisfaire ses besoins et reste indifférent à ceux des autres. Et pour que les hommes puissent vivre ensemble, pour éviter l’état hobbésien du « Tous contre tous » et, au contraire, grâce à l’entraide et la production accrue qui en dérive, satisfaire une plus grande somme de leurs désirs, il faut des instances régulatrices, qui tracent des limites à ces désirs, et arbitrent les conflits : ce mécanisme, c’est la Loi. Mais il faut encore que les hommes, égoïstes et veules, acceptant la contrainte de la Loi, et celle-ci ainsi doit se référer à une instance extérieure à l’homme, doit être fondée sur une puissance que l’homme ressente comme supérieure à lui-même. Comme je l’avais suggéré à Eichmann, lors de notre diner, cette référence suprême et imaginaire a long temps été l’idée de Dieu ; de ce Dieu invisible et tout puissant, elle a glissé vers la personne physique du roi, souverain de droit divin ; et quand ce roi a perdu [845] la tête, la souveraineté est passée au Peuple ou à la Nation, et s’est fondée sur un « contrat » fictif, sans fondement historique ou biologique, et donc aussi abstrait que l’idée de Dieu. Le national-socialisme allemand a voulu l’ancrer dans le Volk, une réalité historique : le Volk est souverain, et le Führer exprime ou représente ou incarne cette souveraineté. De cette souveraineté dérive la Loi, et pour la plupart des hommes, de tous les pays, la morale n’est pas autre chose que la Loi : dans ce sens, la loi morale kantienne, dont se préoccupait tant Eichmann, dérivée de la raison et identique pour tous les hommes, est une fiction comme toutes les lois (mais peut-être une fiction utile). La Loi biblique dit : Tu ne tueras point, et ne prévoit aucune exception ; mais tout juif ou chrétien accepte qu’en temps de guerre cette loi-là est suspendue, qu’il est juste de tuer l’ennemi de son peuple, qu’il n’y a la aucun péché ; la guerre finie, les armes raccrochées, l’ancienne loi reprend son cours paisible, comme si l’interruption n’avait jamais eu lieu. Ainsi, pour un Allemand, être un bon Allemand signifie obéir aux lois et donc au Führer : de moralité, il ne peut y en avoir d’autre, car rien ne saurait la fonder (et ce n’est pas un hasard si les rares opposants au pouvoir furent en majorité des croyants : ils conservaient une autre référence morale, ils pouvaient arbitrer le Bien et le Mal selon un autre référent que le Führer, et Dieu leur servait de point d’appui pour trahir leur chef et leur pays : sans Dieu, cela leur aurait été impossible, car on puiser la justification ? Quel homme seul, de sa propre volonté, peut trancher et dire, Ceci est bien, cela est mal ? Quelle démesure ce serait, et quel chaos aussi, si chacun s’avisait d’en faire de même : que chaque homme vive selon sa Loi [846] privée, si kantienne soit-elle, et nous voici de nouveau chez Hobbes). Si donc on souhaite juger les actions allemandes durant cette guerre comme criminelles, c’est à toute l’Allemagne qu’il faut demander des comptes, et pas seulement aux Döll. Si Döll s’est retrouvé à Sobibor et son voisin non, c’est un hasard, et Döll n’est pas plus responsable de Sobibor que son voisin plus chanceux ; en même temps, son voisin est aussi responsable que lui de Sobibor, car tous deux servent avec intégrité et dévotion le même pays, ce pays qui a créé Sobibor. Un soldat, lorsqu’il est envoyé au front, ne proteste pas ; non seulement il risque sa vie, mais on l’oblige à tuer, même s’il ne veut pas tuer ; sa volonté abdique ; s’il reste à son poste, c’est un homme vertueux, s’il fuit, c’est un déserteur, un traître. L’homme envoyé dans un camp de concentration, comme celui affecté à un Einsatzkommando ou à un bataillon de la police, la plupart du temps ne raisonne pas autrement : il sait, lui, que sa volonté n’y est pour rien, et que le hasard seul fait de lui un assassin plutôt qu’un héros, ou un mort. Ou bien alors il faudrait considérer ces choses d’un point de vue moral non plus judéo-chrétien (ou laïque et démocratique, ce qui revient strictement au même), mais grec : les Grecs, eux, faisaient une place au hasard dans les affaires des hommes (un hasard, il faut le dire, souvent déguisé en intervention des dieux), mais ils ne considéraient en aucune façon que ce hasard diminuait leur responsabilité. Le crime se réfère à l’acte, non pas à la volonté. Œdipe, lorsqu’il tue son père, ne sait pas qu’il commet un parricide ; tuer sur la route un étranger qui vous a insulté, pour la conscience et la loi grecques, est une action légitime, il n’y a là aucune faute ; mais cet homme, c’était Laïos, et [847] l’ignorance ne change rien au crime : et cela, Œdipe le reconnaît, et lorsqu’enfin il apprend la vérité, il choisit lui-même sa punition, et se l’inflige. Le lien entre volonté et crime est une notion chrétienne, qui persiste dans le droit moderne ; la loi pénale, par exemple, considère l’homicide involontaire ou négligent comme un crime, mais moindre que l’homicide prémédité ; il en va de même pour les concepts juridiques qui atténuent la responsabilité en cas de folie ; et le XIXe siècle a achevé d’arrimer la notion de crime à celle de l’anormal. Pour les Grecs, peu importe si Héraclès abat ses enfants dans un accès de folie, ou si Œdipe tue son père par accident : cela ne change rien, c’est un crime, ils sont coupables ; on peut les plaindre, mais on ne peut les absoudre — et cela même si souvent leur punition revient aux dieux, et non pas aux hommes. Dans cette optique, le principe des procès de l’après-guerre, qui jugeaient les hommes pour leurs actions concrètes, sans prendre en compte le hasard, était juste ; mais on s’y est pris maladroitement ; jugés par des étrangers, dont ils niaient les valeurs (tout en leur reconnaissant les droits du vainqueur), les Allemands pouvaient se sentir déchargés de ce fardeau, et donc innocents : comme celui qui n’était pas jugé considérait celui qui l’était comme une victime de la malchance, il l’absolvait, et du même coup s’absolvait lui-même ; et celui qui croupissait dans une geôle anglaise, ou un goulag russe, faisait de même. Mais pouvait-il en être autrement ? Comment, pour un homme ordinaire, une chose peut-elle être juste un jour, et un crime le lendemain ? Les hommes ont besoin d’être guidés, ce n’est pas leur faute. Ce sont des questions complexes et il n’y a pas de réponses simples. La Loi, qui sait où elle se trouve ? Chacun [848] doit la chercher, mais cela est difficile, et il est normal de se plier au consensus commun. Tout le monde ne peut pas être un législateur. C’est sans doute ma rencontre avec un juge qui m’a fait réfléchir à tout cela.
« Plus le garde frappe, plus il est obligé de constater que le détenu refuse de se reconnaitre comme un non-humain. A la fin, il ne lui reste plus comme solution qu’à le tuer, ce qui est un constat d’échec définitif. » (p. 891-892)
[890] …Quant à frapper moins même cet homme aux idées progressistes reconnaissait tristement que c’était difficile : si on frappait, détenus avançaient lentement, mais si on ne frappait pas, ils n’avançaient plus du tout.
Avec le Dr. Wirths j’eus une discussion intéressante au sujet, justement, de cette question de la violence physique, car elle évoquait pour moi des problèmes déjà rencontrés aux Einsatzgruppen. Wirths était d’accord avec moi pour dire que même les hommes qui, au début, frappaient uniquement par obligation, finissaient par y prendre goût. « Loin de corriger des criminels endurcis, affirmait-il avec, passion, nous les confirmons dans leur perversité en leur donnant tous les droits sur les autres prisonniers. Et nous en créons même de nouveaux parmi nos SS. Ces camps, avec les méthodes actuelles, sont une pépinière de maladies mentales et de déviations sadiques ; après la guerre, quand ces hommes rejoindront la vie civile, nous nous retrouverons avec un problème considérable sur les bras. » Je lui expliquai que, d’après ce que l’on disait, la décision de transférer l’extermination vers des camps venait en partie des problèmes psychologiques qu’elle suscitait au sein des troupes affectées aux exécutions de masse. « Certes, répondit Wirths, mais on n’a fait que déplacer le problème, notamment en mêlant les fonctions d’extermination aux fonctions correctionnelles et économiques des camps ordinaires. La mentalité engendrée par l’extermination déborde et affecte tout le reste. Ici même, dans mes Reviere, j’ai découvert que des médecins assassinaient des patients, allant au-delà des instructions. J’ai eu beaucoup de mal à mettre fin à ces pratiques. Quant aux dérives [891] sadiques, elles sont très fréquentes, surtout chez les gardes, et souvent liées à des troubles sexuels. » — « Vous avez des exemples concrets ? » — « C’est rare qu’ils viennent me consulter. Mais cela arrive. Il y a un mois, j’ai vu un garde qui est ici depuis un an. Un homme de Breslau, trente-sept ans, marié, trois enfants. Il m’a avoué qu’il battait des détenus jusqu’à ce qu’il éjacule, sans même se toucher. Il n’avait plus aucun rapport sexuel normal ; quand il recevait une permission, il ne rentrait pas chez lui, tellement il avait honte. Mais avant de venir à Auschwitz, m’a-t-il affirmé il était parfaitement normal. » — « Et qu’avez-vous fait pour lui ? » — « Dans ces conditions-ci, je ne peux pas grand-chose. Il lui faudrait un traitement psychiatrique soutenu. J’essaye de le faire muter, hors du système des camps, mais c’est difficile : je ne peux pas tout dire, sinon il sera arrêté. Or c’est un malade, il a besoin d’être soigné. » — « Et comment croyez-vous que ce sadisme se développe ? demandai-je. Je veux dire chez des hommes normaux, sans aucune prédisposition qui ne ferait que se révéler dans ces conditions ? » Wirths regardait par la fenêtre, pensif. Il mit un long moment avant de répondre : « C’est une question à laquelle j’ai beaucoup réfléchi, et il est malaisé d’y répondre. Une solution facile serait de blâmer notre propagande, telle par exemple qu’elle est enseignée ici aux troupes par l’Oberscharfuhrer Knittel, qui dirige la Kulturabteilung : le Häftling est un sous-homme, il n’est même pas humain, il est donc tout à fait légitime de le frapper. Mais ce n’est pas tout à fait ça : après tout, les animaux ne sont pas humains non plus, mais aucun de nos gardes ne traiterait un animal comme il traite les Häftlinge. La propagande joue en effet un rôle, mais d’une manière plus complexe. J’en suis arrivé à la conclusion que le garde SS ne devient pas violent ou sadique part qu’il pense que le détenu n’est pas un être humain, au contraire, sa rage croît et tourne au sadisme, lorsqu’il s’aperçoit que le détenu, loin d’être un sous-homme comme on le lui a appris, est justement après tout, un homme, comme lui au fond, et c’est cette résistance, vous voyez, que le garde trouve insupportable, cette persistance muette de l’autre, et donc le garde le frappe pour essayer de faire disparaitre leur humanité commune. Bien entendu, cela ne marche pas : plus le garde frappe, plus il est obligé de constater que le détenu refuse de se reconnaitre comme un non-humain. A la fin, il ne lui reste plus comme solution qu’à le tuer, ce qui est un constat d’échec définitif. » Wirths se tut. Il regardait toujours par la fenêtre. Je rompis le silence : « Je peux vous poser une question personnelle, docteur ? » Wirths répondit sans me regarder ; ses longs doigts fins tapotaient la table : « Vous pouvez la poser.» — « Êtes-vous croyant ? » Il mit un moment à répondre. Il regardait encore dehors, vers la rue et le crématorium. « Je l’ai été, oui », dit-il enfin.
« C’était peut-être dans la séduction des mots la raison d’être de nos “Sprachregelungen”, utiles pour tenir ceux qui se servaient de ces mots et de ces expressions entre les pointes acérée leur abstraction » (p. 900-903)
[900] Les mots me préoccupaient. Je m’étais demandé dans quelle mesure les différences entre Allemands et Russes, en termes de réaction aux tueries de masse, et qui faisaient que nous avions finalement dû changer de méthode, pour atténuer la chose en quelque sorte, alors que les Russes semblaient, même après un quart de siècle, y rester imperméables, pouvaient tenir à des différences de vocabulaire : le mot Tod, après tout, a la raideur d’un cadavre déjà froid, propre, presque abstrait, la finalité en tout cas de l’après-mort, tandis que smiert’, le mot russe, est lourd et gras comme la chose elle-même. Et le français, dans ce cas ? Cette langue, pour moi, restait tributaire de la féminisation de la mort par le latin : quel écart finalement entre la Mort et toutes les images presque chaudes et tendres qu’elle suscite, et le terrible Thanatos des Grecs ! Les Allemands, eux, avaient au moins préservé le masculin (smiert‘, soit dit en passant, est aussi un féminin). La, dans la clarté de l’été, je [901] songeais çà cette décision que nous avions prise, cette idée extraordinaire de tuer tous les Juifs, quels qu’ils soient, jeunes ou vieux, bons ou mauvais, de détruire le Judaïsme en la personne de ses porteurs, décision qui avait reçu le nom, bien connu maintenant d’Endlösung : la « solution finale ». Mais quel beau mot ! Pourtant, il n’avait pas toujours été synonyme d’extermination : depuis le début, on réclamait, pour les Juifs, une Endlösung, ou bien une völlige Lösung (solution complète) ou encore une allgemeine Lösung (solution générale), et selon les époques cela signifiait exclusion de la vie publique, exclusion de la vie économique, enfin émigration. Et peu à peu, la signification avait glissé vers l’abîme, mais sans que le signifiant, lui, changé, et c’était presque comme si ce sens définitif avait toujours vécu au cœur du mot, et que la chose avait été attirée, happée par lui, par son poids, sa pesanteur démesurée, dans ce trou noir de l’esprit, jusqu’à la singularité : et alors on avait passé l’horizon des événements, à partir duquel il n’y a plus de retour. On croit encore aux idées, aux concepts, on croit que les mots désignent des idées, mais ce n’est pas forcément vrai, peut-être n’y a-t-il pas vraiment d’idées, peut-être n’y a-t-il réellement que des mots, et le poids propre aux mots. Et peut-être ainsi nous étions-nous laissé entraîner par un mot et son inévitabilité. En nous, donc, il n’y aurait eu aucune idée, aucune logique, aucune cohérence ? Il n’y aurait eu que des mots dans notre langue si particulière, que ce mot-là, Endlösung, sa beauté ruisselante ? Car en vérité comment résister à la séduction d’un tel mot ? C’eût été aussi inconcevable que de résister au mot obéir au mot servir, au mot loi. Et c’était peut-être là, au fond, la raison d’être de nos Sprachregelungen, [902] assez transparentes finalement en termes de camouflage (Tarnjargon), mais utiles pour tenir ceux qui se servaient de ces mots et de ces expressions — derbehandlung (traitement spécial), abtransportiert (transporté plus loin), entsprechend behandelt (traité de manière appropriée), Wohnsitzverlegung (changement de domicile), ou Executivmassnahmen (mesures exécutives) — entre les pointes acérée leur abstraction. Cette tendance s’étendait a notre langage bureaucratique, notre bürokratisches Amtsdeutsch, comme disait mon collègue Eichmann : dans les correspondances, dans les discours aussi, les tournures passives dominaient, « il a été décidé que… », « les Juifs ont été convoyés aux mesures spéciales », « cette tâche difficile a été accomplie », et ainsi les choses se faisaient toutes seules, personne ne faisait jamais rien, personne n’agissait, c’étaient des actes sans acteurs, ce qui toujours rassurant, et d’une certaine façon ce n’étaient même pas des actes, car par l’usage particulier que notre langue nationale-socialiste faisait de certains noms, on parvenait, sinon à entièrement éliminer les verbes, du moins à les réduire à l’état d’appendices inutiles (mais néanmoins décoratifs et ainsi, on se passait même de l’action, il y avait seulement des faits, des réalités brutes soit déjà présentes, soit attendant leur accomplissement inévitable, comme l’Einsatz, ou l’Einbruch (la percée), la Verwertung (l’utilisation), l’Entpolonisierung (la dépolonisation), l’Ausrottung (l’extermination), mais aussi, en sens contraire, la Versteppung, la « steppisation » de l’Europe par les hordes bolcheviques qui, à l’opposé d’Attila, rasaient la civilisation afin de laisser repousser l’herbe à chevaux. Man lebt in seiner Sprache, écrivait Hanns Johst, un de nos [903] meilleurs poètes nationaux-socialistes : « L’Homme vit dans sa langue ».
La franchise du discours de Himmler ; Le tribunal des vainqueurs ; « Si l’on s’engage dans une refonte de la société par la violence, tôt ou tard les Juifs en font les frais » (p. 949-960)
[948] Du discours d’une heure et demie que prononça le Reichsführer le 6 octobre au soir devant les Reichsleiter [949] et Gauleiter assemblés, j’ai peu à dire. Ce discours est moins connu que celui, presque deux fois plus long, qu’il lut le 4 octobre à ses Obergruppenführer et ses HSSPF ; mais à part quelques différences dues à la nature des auditoires respectifs, et le ton moins informel, moins sardonique, moins lardé d’argot du second discours, le Reichsführer disait essentiellement la même chose. Par le hasard de la survie d’archives et de la justice des vainqueurs, ces discours sont devenus célèbres bien en dehors des cercles fermés auxquels ils étaient destinés ; vous ne trouverez pas un ouvrage sur la SS, sur le Reichsführer, ou sur la destruction des Juifs où ils ne soient pas cités ; si leur contenu vous intéresse, vous pouvez aisément les consulter, et en plusieurs langues ; le discours du 4 octobre figure tout entier au protocole du grand procès de Nuremberg, sous la cote 1919-PS (c’est évidemment sous cette forme que j’ai enfin pu l’étudier en détail, après la guerre, bien que dans les grandes lignes j’en eusse pris connaissance à Posen même) ; il a d’ailleurs été enregistré, soit sur disque, soit sur une bande magnétique à l’oxyde rouge, les historiens ne sont pas d’accord et sur ce point je ne peux pas les éclairer, n’ayant pas été présent à ce discours-là, mais quoi qu’il en soit l’enregistrement a survécu et, si le cœur vous en dit, vous pouvez l’écouter, et ainsi entendre par vous-même la voix monotone, pédante, didactique et précise du Reichsführer, un peu plus pressée lorsqu’il ironise, avec même, mais rarement, des pointes de colère, surtout évidentes, avec le recul, quand il en arrive aux sujets sur lesquels il devait sentir qu’il avait peu de prise, la corruption généralisée par exemple, dont il a aussi parlé le 6 devant les dignitaires du régime, mais sur laquelle il a surtout [950] insisté cela, je l’ai su à l’époque par Brandt, lors de son discours aux Gruppenführer prononcé le 4. Or si ces discours sont entrés dans l’Histoire, ce n’est bien entendu pas à cause de cela, mais surtout parce que le Reichsführer, avec une franchise qu’il n’a jamais à ma connaissance égalée ni avant ni après, avec franchise donc et d’une manière qu’on pourrait même dire crue, y dressait le programme de la destruction des Juifs. Même moi, lorsque j’entendis cela le 6 octobre, je n’en crus tout d’abord pas mes oreilles, la salle était comble, la somptueuse salle Dorée du château de Posen, j’étais tout à fait au fond, derrière une cinquantaine de dirigeants du Parti et des Gaue, sans parler de quelques industriels, de deux chefs de service, et de trois (ou peut-être deux) ministres du Reich ; et je trouvai cela, eu égard aux règles du secret auxquelles on nous avait astreints, véritablement choquant, indécent presque, et au début cela me mit très mal à l’aise, et je n’étais certainement pas le seul, je voyais des Gauleiter soupirer et essuyer leurs nuques ou leurs fronts, ce n’était pas qu’ils apprenaient là quelque chose de nouveau, personne, dans cette grande salle aux lumières feutrées, ne pouvait ne pas être au courant, même si certains, jusque-là, n’avaient sans doute pas cherché à penser la chose jusqu’au bout, à en discerner toute l’étendue, à songer, par exemple, aux femmes et aux enfants, et c’est probablement pourquoi le Reichsführer insista sur ce point, nettement plus, d’ailleurs, devant les Reichsleiter et les Gauleiter que devant ses Gruppenführer, qui eux en aucun cas ne pouvaient se faire d’illusions, sans doute pourquoi il insista que oui, nous tuions bien les femmes et les enfants aussi, pour ne laisser subsister aucune ambiguïté, et c’est justement cela qui était si inconfortable [951] , cette absence totale, pour une fois, d’ambiguïté, et c’était comme s’il violait une règle non écrite, plus forte encore que ses propres règles édictées à l’intention de ses subordonnés, ses Sprachregelungen pourtant absolument strictes, la règle du tact peut-être, de ce tact dont il parla dans son premier discours, l’évoquant dans le contexte de l’exécution de Röhm et de ses camarades SA, une sorte de tact naturel parmi nous, Dieu merci, dit-il, une conséquence de ce tact qui a fait que nous n’en avons jamais parlé entre nous, mais peut-être s’agissait-il encore d’autre chose que de la question de ce tact et de ces règles, et c’est là que je commençai à comprendre, je crois, la raison profonde de ces déclarations, et aussi pourquoi les dignitaires soupiraient et suaient autant, car eux aussi, comme moi, commençaient à comprendre, à comprendre que ce n’était pas un hasard si le Reichsführer, ainsi, au début de la cinquième année de la guerre, évoquait ouvertement devant eux la destruction des Juifs, sans euphémismes, sans clins d’œil, avec des mots simples et brutaux comme tuer — exterminer, dit-il, je veux dire tuer ou donner l’ordre de tuer que, pour une fois, le Reichsführer leur parlait ouvertement de cette question… pour vous dire comment sont les choses, non, ce n’était certes pas un hasard, et s’il se permettait de le faire, alors le Führer était au courant, et pis, le Führer l’avait voulu, d’où leur angoisse, le Reichsführer parlait forcément ici au nom du Führer, et il disait cela, ces mots-là qu’on ne devait pas dire, et il les enregistrait, sur disque ou sur bande, peu importe, et il prenait soigneusement note des présents et des absents — parmi les chefs de la SS, seuls n’assistèrent pas au discours du 4 octobre Kaltenbrunner, qui souffrait de phlébite, [952] Daluege, sérieusement malade du cœur et en congé pour un an ou deux, Wolff, tout juste nommé HSSPF pour l’Italie et plénipotentiaire auprès de Mussolini, et Globocnik, qui venait, je ne le savais pas encore et ne l’appris qu’après Posen, d’être subitement muté de son petit royaume de Lublin à sa ville natale de Trieste, comme SSPF pour l’Istrie et la Dalmatie, sous les ordres de Wolff justement, accompagné d’ailleurs, mais cela je le sus encore plus tard, de presque tout le personnel de l’Einsatz Reinhard, T-4 compris, on liquidait tout, Auschwitz suffirait dorénavant, et la belle côte Adriatique ferait un beau dépotoir pour tous ces gens dont on n’avait plus l’usage, même Blobel viendrait les rejoindre un peu plus tard, qu’ils aillent se faire tuer par les partisans de Tito, cela nous épargnerait une partie du ménage ; et quant aux dignitaires du Parti, note fut prise aussi des têtes manquantes, mais je n’ai jamais vu la liste — tout cela, donc, le Reichsführer le faisait délibérément, sur instructions, et à cela il ne pouvait y avoir qu’une raison, d’où l’émoi perceptible des auditeurs, qui la saisissaient fort bien, cette raison : c’était afin qu’aucun d’entre eux ne puisse, plus tard, dire qu’il ne savait pas, ne puisse tenter de faire croire, en cas de défaite, qu’il était innocent du pire, ne puisse songer, un jour, à pouvoir tirer son épingle du jeu ; c’était pour les »mouiller », et ils le comprenaient très bien, d’où leur désarroi. La Conférence de Moscou, à l’issue de laquelle les Alliés jurèrent de poursuivre les « criminels de guerre » »jusqu’au coin le plus reculé de la planète », n’avait pas encore eu lieu, ce serait pour quelques semaines plus tard, avant la fin de ce mois d’octobre 1943, mais déjà la BBC, depuis l’été surtout, menait une propagande intensive sur ce thème, en donnant des [953] noms, avec une certaine précision d’ailleurs, car elle citait parfois des officiers et même des sous-officiers de KL spécifiques, elle était très bien informée, la Staatspolizei se demandait bien comment d’ailleurs, et cela, il est tout à fait exact de le noter, provoquait une certaine nervosité chez les intéressés, d’autant que les nouvelles du front n’étaient pas bonnes, pour tenir l’Italie on avait du dépouiller le front de l’Est, et il y avait peu de chances qu’on puisse rester sur le Donets, on avait déjà perdu Briansk, Smolensk, Poltava et Krementchoug, la Crimée était menacée, bref, n’importe qui pouvait voir que cela allait mal, et certainement nombreux devaient être ceux qui se posaient des questions sur l’avenir, celui de l’Allemagne en général bien entendu mais le leur en particulier aussi, d’où une certaine efficacité de cette propagande anglaise, qui non seulement démoralisait les uns, cités, mais aussi les autres, pas encore cités, en les encourageant à penser que la fin du Reich ne signifierait pas automatiquement leur propre fin, et rendant donc le spectre de la défaite un tout petit peu moins inenvisageable, d’où ainsi, on peut le concevoir, en ce qui concernait en tout cas les cadres du Parti, de la SS et de la Wehrmacht, la nécessité de leur faire comprendre qu’une éventuelle défaite les concernerait aussi, personnellement, histoire de les remotiver un peu, que les prétendus crimes des uns seraient aux yeux des Alliés les crimes de tous, au niveau de l’appareil en tout cas, que tous les bateaux, ou les ponts, comme on préfère, flambaient, qu’il n’y avait aucun retour en arrière possible, et que le seul salut était la victoire. Et en effet la victoire aurait tout réglé, car si nous avions gagné, imaginez-le un instant, si l’Allemagne avait écrasé les Rouges et détruit l’Union [954] soviétique, il n’aurait plus jamais été question de crimes, ou plutôt si, mais de crimes bolcheviques, dûment documentés grâce aux archives saisies (les archives du NKVD de Smolensk, évacuées en Allemagne et récupérées à la fin de la guerre par les Américains, jouèrent précisément ce rôle, lorsque fut enfin venu le temps où il fallut presque du jour au lendemain expliquer aux bons électeurs démocratiques pourquoi les monstres infâmes de la veille devaient maintenant servir de rempart contre les héroïques alliés de la veille, aujourd’hui révélés comme monstres pires encore), voire peut-être, pour reprendre, par des procès en règle, pourquoi pas, le procès des meneurs bolcheviques, imaginez ça, pour faire sérieux comme ont voulu le faire les Anglo-Américains (Staline, on le sait, se moquait de ces procès, il les prenait pour ce qu’ils étaient, une hypocrisie, inutile de surcroît), et ensuite tout le monde, Anglais et Américains en tête, aurait composé avec nous, les diplomaties se seraient réalignées sur les nouvelles réalités, et malgré l’inévitable braillement des Juifs de New York, ceux d’Europe, qui de toute façon n’auraient manqué à personne, auraient été passés par pertes et profits, comme tous les autres morts d’ailleurs, tsiganes, polonais, que sais-je, l’herbe pousse dru sur les tombes des vaincus, et nul ne demande de comptes au vainqueur, je ne dis pas cela pour tenter de nous justifier, non, c’est la simple et effroyable vérité, regardez donc Roosevelt, cet homme de bien, avec son cher ami Uncle Joe, combien donc de millions Staline en avait-il déjà tué, en 1941, ou même avant 1939, bien plus que nous, c’est sûr, et même si l’on dresse un bilan définitif il risque fort de rester en tête, entre la collectivisation, la dékoulakisation, les grandes purges et les [955] déportations des peuples en 1943 et 1944, et cela, on le savait bien, à l’époque, tout le monde savait plus ou moins, durant les années 30, ce qui se passait en Russie, Roosevelt le savait aussi, cet ami des hommes, mais ça ne l’a jamais empêché de louer la loyauté et l’humanité de Staline, en dépit d’ailleurs des avertissements répétés de Churchill, un peu moins naïf d’un certain point de vue, un peu moins réaliste, d’un autre, et si donc nous autres avions en effet gagné cette guerre, il en aurait certainement été de même, petit à petit, les obstinés qui n’auraient cessé de nous appeler les ennemis du genre humain se seraient tus un à un, faute de public, et les diplomates auraient arrondi les angles, car après tout, n’est-ce pas, Krieg ist Krieg and Schnaps ist Schnaps, et ainsi va le monde. Et peut-être même en fin de compte aurait-on applaudi nos efforts, comme l’a souvent prédit le Führer, ou peut-être pas, quoi qu’il en soit beaucoup auraient applaudi, qui entre-temps se sont tus, car nous avons perdu, dure réalité. Et même si une certaine tension avait persisté à ce sujet, dix ou quinze ans durant, elle se serait tôt ou tard dissipée, quand par exemple nos diplomates auraient fermement condamné, mais tout en se ménageant la possibilité de faire preuve d’un certain degré de compréhension, les dures mesures, susceptibles de nuire aux droits de l’homme, qu’auraient un jour ou l’autre dû appliquer la Grande-Bretagne ou la France afin de restaurer l’ordre dans leurs colonies rétives, ou, dans le cas des Etats-Unis, assurer la stabilité du commerce mondial et combattre les foyers de révolte communistes, comme ils ont tous d’ailleurs fini par le faire, avec les résultats que l’on sait. Car ce serait une erreur, grave à mon avis, de penser que le sens moral des puissances occidentales [956] diffère si fondamentalement du nôtre : après tout, une puissance est une puissance, elle ne devient pas par hasard, et ne le reste pas non plus, Les Monégasques, ou les Luxembourgeois, peuvent s’offrir le luxe d’une certaine droiture politique ; c’est un peu différent pour les Anglais. N’était-ce pas administrateur britannique, éduqué a Oxford ou Cambridge, qui dès 1922 préconisait des »massacres administratifs » pour assurer la sécurité des colonies et regrettait amèrement que la situation politique in the Home Islands rendît impossibles ces mesures salutaires ? Ou, si l’on souhaite comme certains imputer toutes nos fautes au compte du seul antisémitisme — une erreur grotesque, à mon avis, mais séduisante pour beaucoup —, ne faudrait-il pas reconnaître que la France, à la veille de la Grande Guerre, faisait bien plus fort en ce domaine que nous (sans parler de la Russie des pogromes !) ? J’espère que vous ne serez pas trop surpris d’ailleurs que je dévalorise ainsi l’antisémitisme comme cause fondamentale du massacre des Juifs : ce serait oublier que nos politiques d’extermination allaient chercher bien plus loin. A la défaite — et loin de vouloir réécrire l’Histoire, je serais le premier à le reconnaître — nous avions déjà, outre les Juifs, achevé la destruction de tous les handicapés physiques et mentaux incurables allemands, de la majeure partie des Tsiganes, et de millions de Russes et de Polonais. Et les projets, on le sait, étaient encore plus ambitieux : pour les Russes, la »diminution naturelle » nécessaire devait atteindre selon les experts du Plan quadriennal et du RSHA trente millions, voire se situer entre quarante-six et cinquante et un millions selon l’avis dissident d’un Dezernent un peu zélé de l’Ostministerium. Si la [957] guerre avait encore duré quelques années, nous aurions certainement entamé une réduction massive des Polonais. L’idée était déjà dans l’air du temps depuis un moment : voyez la volumineuse correspondance entre le Gauleiter Greiser du Warthegau et le Reichsführer, ou Greiser demande, à partir de mai 1942, la permission de se servir des installations de gazage de Kulmhof pour détruire 35 000 Polonais tuberculeux qui constituaient, selon lui, une grave menace de santé pour son Gau ; le Reichsführer, au bout de sept mois, lui fit enfin comprendre que sa proposition était intéressante, mais prématurée. Vous devez trouver que je vous entretiens bien froidement de tout cela : c’est simplement afin de vous démontrer que la destruction par nos soins du peuple de Moïse ne procédait pas uniquement d’une haine irrationnelle pour les Juifs — je crois avoir déjà montré à quel point les antisémites du type émotionnel étaient mal vus au SD et a la SS en général — mais surtout d’une acceptation ferme et raisonnée du recours à la violence pour la résolution des problèmes sociaux les plus variés, ce en quoi, d’ailleurs, nous ne différions des bolcheviques que par nos appréciations respectives des catégories de problèmes à résoudre : leur approche étant fondée sur une grille de lecture sociale horizontale (les classes), la nôtre, verticale (les races), mais toutes deux également déterministes (je crois l’avoir déjà souligné) et parvenant à des conclusions similaires en termes de remède à employer. Et si l’on y réfléchit bien, on pourrait en déduire que cette volonté, ou du moins cette capacité à accepter la nécessité d’une approche bien plus radicale des problèmes affligeant toute société, ne peut être née que de nos défaites lors de la Grande Guerre. Tous les pays [958] (sauf peut-être les Etats-Unis) ont souffert ; mais la victoire, et l’arrogance et le confort moral nés de la victoire, ont sans doute permis aux Anglais et aux Français et même aux Italiens d’oublier plus facilement leurs souffrances et leurs pertes, et de se rasseoir, parfois même de se vautrer dans leur autosatisfaction, et donc aussi de prendre peur plus facilement, de crainte de voir se désagréger ce si fragile compromis. Quant à nous, nous n’avions plus rien à perdre. Nous nous étions battus aussi honorablement que nos ennemis ; on nous a traités comme des criminels, on nous a humiliés et dépecés, et on a bafoué nos morts. Le sort des Russes, objectivement, n’a guère été meilleur. Quoi de plus logique, alors, que d’en venir à se dire : Eh bien, s’il en est ainsi, s’il est juste de sacrifier le meilleur de la Nation, d’envoyer à la mort les hommes les plus patriotes, les plus intelligents, les plus dévoués, les plus loyaux de notre race, et tout cela au nom du salut de la Nation — et que cela ne serve à rien — et que l’on crache sur leur sacrifice — alors, quel droit à la vie garderaient les pires éléments, les criminels, les fous, les débiles, les asociaux, les Juifs, sans parler de nos ennemis extérieurs ? Les bolcheviques, j’en suis convaincu, ont raisonné de la même manière. Puisque respecter les règles de la prétendue humanité ne nous a servi à rien, pourquoi s’entêter dans ce respect dont on ne nous a même pas su gré ? De là, inévitablement, une approche beaucoup plus raide, plus dure, plus radicale de nos problèmes. Dans toutes les sociétés, en tout temps, les problèmes sociaux ont connu un arbitrage entre les besoins de la collectivité et les droits de l’individu, et ont donc donné lieu à un nombre de réponses somme toute fort limité : schématiquement [959] la mort, la charité, ou l’exclusion (surtout, historiquement, sous la forme de l’exil extérieur). Les Grecs exposaient leurs enfants difformes ; les Arabes, reconnaissant qu’ils constituaient, économiquement parlant, une charge trop lourde pour leurs familles, mais ne souhaitant pas les tuer, les plaçaient à la charge de la communauté, par le mécanisme de la zakat, la charité religieuse obligatoire (un impôt pour les bonnes œuvres) ; de nos jours encore, chez nous, il existe des établissements spécialisés pour de tels cas, afin que leur malheur n’afflige pas la vue des bien-portants. Or, si l’on adopte une telle vision d’ensemble, on peut constater qu’en Europe du moins, à partir du XVIIIe siècle, toutes les solutions distinctes aux divers problèmes — le supplice pour les criminels, l’exil pour les malades contagieux (léproseries), la charité chrétienne pour les imbéciles — ont convergé, sous l’influence des Lumières, vers un type de solution unique, applicable à tous les cas et déclinable à volonté : l’enfermement institutionnalisé, financé par l’Etat, une forme d’exil intérieur si l’on veut, à prétention pédagogique parfois, mais surtout à finalité pratique : les criminels, en prison, les malades, l’hôpital, les fous, à l’asile. Qui ne peut pas voir que ces solutions si humaines, elles aussi, résultaient de compromis, étaient rendues possibles par la richesse, et restaient, en fin de compte, contingentes ? Après la Grande Guerre beaucoup ont compris qu’elles n’étaient plus adaptées, qu’elles ne suffisaient plus pour faire face à la nouvelle ampleur des problèmes, du fait de la restriction des moyens économiques et aussi du niveau, autrefois impensable, des enjeux (les millions de morts de la guerre). Il fallait de nouvelles solutions, on les a trouvées, [960] comme l’homme trouve toujours les solutions qu’il lui faut, comme aussi les pays dits démocratiques auraient trouvées, s’ils en avaient eu besoin. Mais pourquoi alors, demanderait-on aujourd’hui, les Juifs ? Qu’est-ce que les Juifs ont à voir avec les fous, vos criminels, vos contagieux ? Pourtant ce n’est pas difficile de voir que, historiquement, les Juifs se sont eux-mêmes constitués comme « problème » en voulant à tout prix rester à part. Les premiers écrits contre les Juifs, ceux des Grecs d’Alexandrie, bien avant le Christ et l’antisémitisme théologique, ne les accusaient-ils pas d’être des asociaux, de violer les lois de l’hospitalité, fondement et principe politique majeur du monde antique, nom de leurs interdits alimentaires, qui les empêchaient d’aller manger chez les autres ou de les recevoir, d’être des hôtes ? Ensuite, bien entendu, il y a eu la question religieuse. Je ne cherche pas comme on pourrait le croire, à rendre les Juifs responsables de leur catastrophe ; je cherche simplement à dire qu’une certaine histoire de l’Europe, malheureuse selon les uns, inévitable selon les autres, a fait en sorte que même de nos jours, en temps de crise, il est naturel de se retourner contre les Juifs, et que si l’on s’engage dans une refonte de la société par la violence, tôt ou tard les Juifs en font les frais — tôt, dans notre cas, tard, dans celui des Soviétiques — et que ce n’est pas tout à fait un hasard.
Notes
- Thomas est l’ami fidèle de Maximilien, celui qui l’a recruté dans la SS alors qu’une affaire trouble dans un bois connu pour sa fréquentation par les homosexuels l’avait conduit à être interrogé par la Gestapo où il était menacé de prison, et qu’il retrouvera dans tout son parcours d’Ukraine à Berlin en passant pas Stalingrad. Thomas, qui aime les intrigues politiques et les luttes de factions internes contrairement à Maximilien qui cultive la plus grande indifférence pour celles-ci et que la formation de droit n’a pas amené à faire beaucoup de polémologie, peut s’étonner de retrouver de telles réflexions dans la bouche de son camarade. ↩︎
- Officier, souvent pilote aussi, commissaire politique du régiment. ↩︎
- Fonctionnaire, bureaucrate. ↩︎
- De même que Byzance, la deuxième Rome, avait supplanté la première lors des invasions barbares, certains écrivains russes du XVIe siècle, qui considéraient que l’une et l’autre avaient successivement failli à leur mission de diriger la chrétienté, revendiquèrent pour Moscou, avec le titre de Troisième Rome, le droit de relayer Constantinople dans sa suprématie politique et religieuse. (Réf. Universalis) ↩︎
- Cf. Allemandes I et II. Il s’agit du massacre de Babi Yar. ↩︎
- Il s’agit ici, bien évidemment, d’une référence au Eichmann à Jérusalem de Hannah Arendt. ↩︎
Photo d’entête : « Vestiges seconde guerre mondiale, Ile d’ Oleron, Chassiron » par thierry llansades.

Laisser un commentaire