🙂
… Et voilà, l’air de rien je viens d’établir un nouveau record international de nanolittérature avec une nanonouvelle de 0 mot, qui raconte l’histoire sympathique d’un individu heureux et sans histoire.1
Il ne reste plus qu’à me faire passer pour un sud-américain et pondre un bullshitexte autoanalysant2 « la fulgurance évocatrice de la concision de [m]on œuvre », « le rôle du mystère dans la construction infranarrative de [m]es non-textes », « la mort conjointe et nécessairement liée (car intrinsèquement dialectique) de l’auteur, du sujet et du « langage fasciste » (R. Barthes) dans l’esthétique néostructuraliste de [m]a postmodernité métissée et e-transgressiv-e », la « dialectique de l’écriture / non-écriture cybernétique » et dégueulis blablablateux ad nauseam, en vue de participer à un énième colloqualacon universitaire : « Lire / écrire la micro-fiction en Amérique latine : micro-identités, macro-transgressions ».
Passons sur l’aspect « macrotransgressif » : lire des mots comme révolution(naire), transgression, rébellion, décalé-e-s, etc. dans la prose universitaire ne nous tire même plus ni un agacement ni un sourire, au plus un soupire et un long mépris à voir tous ces petits rats de bibliothèque qui ont besoin de se croire jouer un rôle quelconque et de se jouer génération après génération la comédie de leur héroïsme de papier…
Reste ces questions pendantes :
- « en commençant ainsi in media res, l’auteur laisse dans le brouillard tout le contexte de ce sourire et oblige ainsi le lecteur à recréer lui-même l’univers préexistant à cette manifestation de joie, créant par là-même une complicité immédiate avec lui, scellée par ce visage radieux. Mais qui est l’auteur de l’histoire, dans ce cas : l’auteur, le lecteur ou la rencontre des deux pôles faussement opposés par la frontière matérielle du papier ou de l’écran ? » ;
- « est-ce une œuvre de fiction, d’autofiction ou un récit historique ? », « pourquoi le smiley rit-il ? », « en riant, ce qui est le propre de l’homme [Cf. Bergson, Le rire], le smiley est-il ainsi la métaphore d’une humanité désaliénée et réconciliée avec elle-même ? » ;
- « est-ce de la littérature engagée en faveur de la paix dans le monde ? » ;
- « cet attachement aux petites choses simples et fragiles de la vie comme un sourire, répondait-il à un besoin de nos sociétés en ces temps de crise et de changements incessants, qui expliquerait son succès manifesté par le fait que, depuis sa publication, tant de gens le citent dans leur conversation numérique ? »…
Et sinon, c’est quand la journée internationale des coups de pied au cul qui se perdent dans la potentialité inactualisée d’une réalité bien faite qui existe en haut de la pyramide des possibles ? (Que Leibniz ne nous fasse pas croire que celle-ci est la meilleure que Dieu ait pu calculer !)
Épilogue (un rien sérieux, sinon grincheux) en guise d’ouverture
Depuis les années 70, l’université n’est plus une institution qui se tient en marge du monde (régulière) et qui tente de le comprendre de l’extérieur3, mais plus que de vouloir en faire partie, elle devance ce monde en se vautrant dans tout ce qu’il fait de pire, toute frémissante d’être à la pointe de la mode. Est-ce son rôle ? Doit-elle plutôt se tenir hors des modes et des rythmes séculiers de la politique et des media ? Doit-elle s’adapter au monde sur un rythme lent comme le fait l’Église catholique progressiste ou doit-elle résister à tout changement comme le pensent les traditionalistes de cette même Église ?
Je vous laisse réfléchir à ça pendant que je travaille à battre mon propre record littéraire en proposant un morceau de marge (morceau encadré d’un léger trait gris à l’endroit choisi – mais où ? Sur laquelle des quatre marges ?) comme œuvre de ma prochaine contribution…
(En souvenir d’un chouette concert de PoiL à Colmar, ce clip minimaliste)
Notes
- Champagne, filles nues qui dansent sur le bar, musique brésilienne sur fond de BPM du Diable, sous l’œil attendri des petites étudiantes de lettres et des professeurs au bulbe grillé d’avoir lu et fini par croire toutes les âneries savantes dont ils s’abreuvent au quotidien… Qui croit que Cervantès et Revel sont morts ? Ils ont écrit leurs livres hier pour aujourd’hui ! ↩︎
- A l’heure de l’autofiction régnante, de l’épidémie de selfies, du narcissisme érigé en art de vivre dans les réseaux sociaux devenus incontournables, où cela ne choque personne qu’un auteur comme Carrère s’expose dès qu’il le peut dans ses récits où sa personne n’a rien à voir ou encore des thèses “Pratiques et théorie de la création artistique et littéraire” consistant à écrire tout en analysant sa pratique d’écriture en même temps, on peut bien auto-analyser son œuvre, même si elle ne consiste qu’en un smiley, geste richarmuttien s’il en est, non ? ↩︎
- Même si ce point de vue u-topique comme non-engagé, non-“situé”, Wertfrei, est toujours un peu, justement, utopique. ↩︎
Photo d’entête : “Missed Two Deadlines” par Thomas Hawk
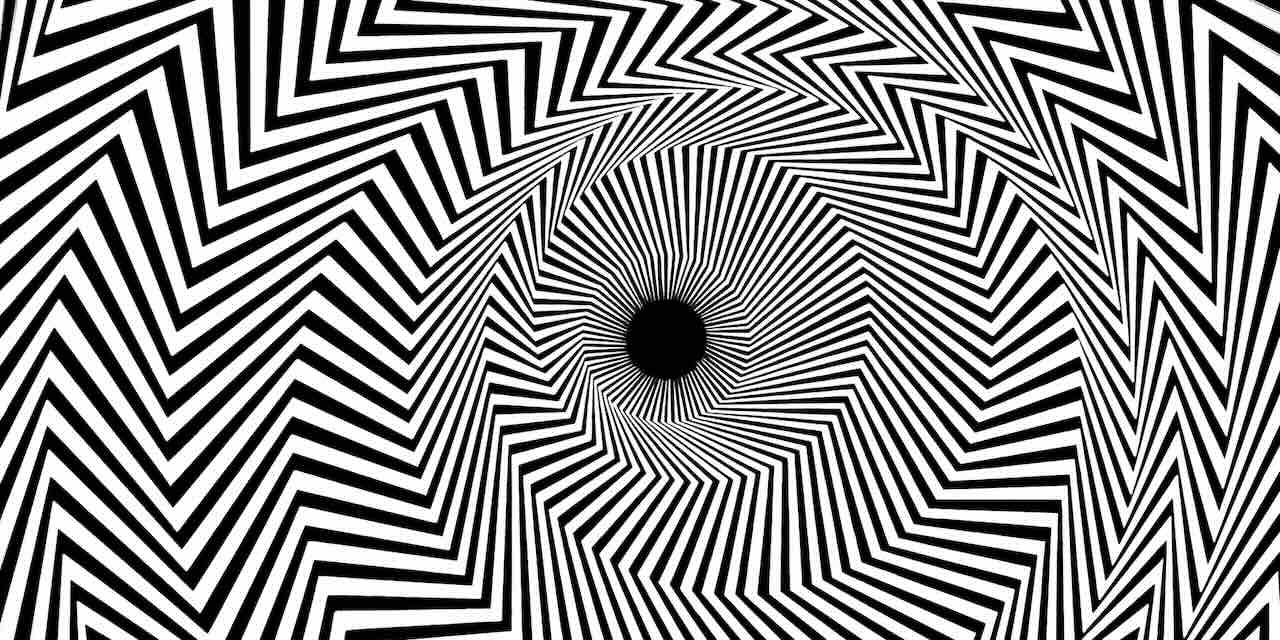
Laisser un commentaire